L'escalade rocheuse et glaciaire
Préambule
L'alpinisme consiste à gravir une montagne, une cime, divers accidents naturels. Des initiatives souvent liées aux incertitudes du milieu naturel et aux sensations attachées à l'altitude. L'objectif est d'atteindre un sommet, qui représente très fréquemment la concrétisation d'un projet.
D'autres pratiques s'intéresseront au seul plaisir du geste sportif, à la seule satisfaction de franchir un obstacle particulier. Des disciplines s'écartant le plus souvent des codes de l'alpinisme et de l'altitude, et avec plusieurs façons de faire :
- L'escalade rocheuse en falaise
- L'escalade rocheuse de bloc
- L'escalade glaciaire en site naturel et artificiel.
Notons que dès 1960, les grimpeurs s'intéresseront déjà aux parois du Vercors et de la Chartreuse. Des escalades qui se terminaient sur les hauts plateaux, avec parfois la rencontre d'un troupeau de moutons tranquillement occupés à brouter l'herbe des lieux. Une pratique qui dérogeait déjà au sacro-saint attrait du sommet de l'époque.
L'ESCALADE ROCHEUSE EN FALAISE
D'abord, au début du XXe siècle en France, une discipline sportive servant principalement à l'entraînement pour l'alpinisme. C'est à partir des années 1980 que certains - en plus grand nombre - se sont écartés des valeurs de la montagne, pour ne retenir que l'intérêt sportif de la pratique…
Depuis cette date, l'escalade rocheuse connaît un engouement remarquable, soit au niveau de la recherche de la plus haute difficulté, soit au niveau de la compétition, soit encore comme activité de loisir.
Une activité qui - généralement - réclame moins d'engagements, moins de contraintes, et surtout propose beaucoup moins d'incertitude que l'alpinisme.
L'ESCALADE DE BLOC
Depuis 1908, peut-être 1906, d'abord en France dans les chaos gréseux de la forêt de Fontainebleau, c'était est une activité également préparatoire à l'alpinisme qui deviendra aussi et peu à peu une façon de faire autonome.
L'ESCALADE GLACIAIRE EN SITE NATUREL ET ARTIFICIEL.
Depuis 1975, la chronologie, d'une nouvelle forme de pratique, sur des surfaces glacées, est proposée, accompagnant les progrès du matériel : crampons et piolets.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sommaire :
- Une chronologie des événements se rapportant à la falaise et au bloc
- Les structures artificielles d'escalade (SAE) et la compétition
1 - L'ESCALADE ROCHEUSE EN FALAISE
- Au XIXe siècle et au début des années 1900
- Les années 1930
- Les années 1940-1950
- Les années 1960-1970 et 1980
- Les années 1990 et 2000
2 - ÉCOLE DE BLOCS
- Dans les années 1900 et 1920
- Dans les années 1930 et 1940
- Dans les années 1950 et 1960
- Dans les années 1970 - 1980 - 2000 et ensuite
3 - L'ESCALADE GLACIAIRE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNE CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS SE RAPPORTANT À LA FALAISE ET AU BLOC
Au moyen d'une chronologie des événements marquants, nous avons voulu montrer l'évolution des différentes manières, dans l'art de grimper, en signalant les faits majeurs et les avancées techniques et éthiques.
Rappelons que comme pour l'alpinisme, l'escalade est une discipline « sans règlement et sans arbitre, fondée sur une éthique non écrite et fluctuante… » ; sauf bien entendu en ce qui concerne les compétitions d'escalade, apparues en 1985 en Europe occidentale.
Avec l'engouement pour l'escalade de la fin du XXe siècle, deux écoles vont nettement se différencier : « l'escalade en falaise » et « l'escalade de blocs ».
Il y a évidemment des connexions entre les façons de faire… Et beaucoup navigueront facilement entre ces deux disciplines.
Escalade rocheuse en falaise
Présentation chronologique de l'escalade en falaise, en regardant principalement ce qui s'est fait en France, mais en conservant quelques repères chez nos collègues étrangers. Cette spécialisation utilise les moyens classiques d'assurage, constitués par les ancrages naturels et artificiels, les connecteurs (mousquetons et dégaines), le baudrier, les chaussons d'escalade et la corde.
Pour le bloc
Nous nous limiterons (pour le moment) aux rochers de Fontainebleau, qui proposent en raccourci ce qui se fait dans le monde particulier du bloc…
Mais d'autres massifs en France ont acquis une belle notoriété comme le site d'Annot.
Ici, le plus souvent, pas de corde, ni les moyens classiques d'assurage, seulement des chaussons d'escalade, c'est le matelas amortisseur - le crash pad - depuis les années 1980, et la parade des collègues qui assurent la sécurité.
Insistons sur l'apprivoisement nécessaire de la technique pour la parade des chutes, qui ne doit pas s'improviser et devrait se pratiquer avec au moins deux pareurs expérimentés.
Une évolution constante
On pourra constater que le haut niveau sportif, atteint aujourd'hui, est le résultat d'une longue approche. D'une évolution constante depuis le début du XXe siècle, d'une avancée technique régulière, avec un temps qui deviendra très étendu consacré à l'entraînement, une sécurité renforcée et un perfectionnement du matériel et des accessoires.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
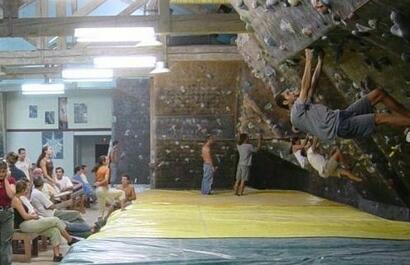
LES STRUCTURES ARTIFICIELLES D'ESCALADE (SAE)
Depuis les années 1980, l'entraînement c'est beaucoup amélioré, avec les structures artificielles ; d'abord sur des éléments basiques, comme le mur de la digue d'Orléans (1958), celui de la citadelle Vauban de Lille (1958), et les salles proposant des murs artificiels spécialisés en Angleterre.
Précurseurs en la matière, comme dans beaucoup d'applications se rapportant à l'alpinisme et à l'escalade, les Britanniques ont développé depuis les années 1960 des salles d'escalade permettant un entraînement par tous les temps… Plusieurs universités se sont dotées de murs en briques.
En France déjà en 1978, la Section Montagne de la FSGT préconise l'utilisation du mur artificiel, pour rendre l'escalade plus populaire.
Un article « Le mur d'escalade », délicieusement suranné, est proposé par Claude Egon dans La Montagne & Alpinisme n°2/1980.
La « Commission d'Enseignement alpin » et celle « des Équipements » du Club Alpin vont publier une étude sur le sujet en 1982.
Grimper sur des structures artificielles se révélera une méthode décisive d'entraînement à l'escalade, annonçant les progrès sportifs important à venir…
En France, les premières enceintes consacrées datent de 1982, d'abord dans le gymnase du lycée de Corbeil, puis dans le milieu associatif.
La première salle d'escalade moderne est ouverte au public en 1987 en Belgique et en 1992 en France.
L'ancienne approche - préconisant un long apprentissage pour devenir d'abord un montagnard, plus tard un grimpeur ou un alpiniste - est rangée dans les placards de l'histoire…
Rapidement, l'escalade sur murs artificiels va se développer, avec les salles spécialisées reproduisant les deux types de grimpe :
< Les salles qui proposent des murs de grande hauteur jusqu'à 20 m et plus, où l'on grimpe avec l'assurage de la corde et au moyen de prises en résine, par des itinéraires marqués de différents niveaux… Les premières enceintes consacrées datent des années 1980. La première salle d'escalade ouverte au public en France date de 1992.
< Les salles de blocs d'une hauteur limitée à 4,70 m, où l'on grimpe sans corde, également à l'aide de prises en résine, sur des itinéraires marqués de différents niveaux, en étant protégé par des matelas amortisseurs.
La première salle d'escalade de blocs en France est créée en 1995, à l'initiative de Vincent Albrand et de Christophe Daconceicao. Alors jeunes grimpeurs et membres de l'équipe de France d'escalade, ils s'entraînaient dans leur garage sur un « micro-mur d'escalade ». Par la suite, leur idée fût d'adapter cet outil d'entraînement, afin qu'il soit accessible au plus grand nombre, la salle d'Aix-en-Provence et le « concept Grimper » étaient nés ! Deux salles à Marseille et à Aix perpétuent la bonne idée, qui depuis a fait des émules. Elles seront transmises à la société Climb'up en 2019.
Les salles Climb'up, à l'initiative de François Petit, vont rapidement devenir une chaîne de salles (bloc et corde). À Lyon d'abord en 2011, Dijon, Épinay, Orléans et Bouc-Bel-Air en 2015 et ensuite plusieurs autres salles dans les Bouches-du-Rhône et ailleurs.
D'autres entreprises similaires sont implantées dans les régions et les principales métropoles.
La compétition d'escalade rocheuse
C'est en Union Soviétique que des compétitions d'escalade apparaîtront après la Seconde Guerre mondiale, elles resteront réservées aux grimpeurs de ces républiques.
Les premières compétitions d'escalade en Europe occidentale sont organisées sur les falaises de Chamonix en juin 1985 et de Bardonecchia en Italie en juillet 1985, ensuite en 1986 à Vaulx-en-Velin sur structure artificielle. Lire un historique au paragraphe : L'escalade en falaise - 1985 - Les premières compétitions d'escalade.
Les précautions insuffisantes prises pour l'environnement, durant les premières manifestations publiques sur falaises naturelles, conduiront à proposer ces manifestations seulement sur structures artificielles.
L'inscription de l'escalade dans les sports olympiques en 2020 (2021) permet les projets les plus inespérés pour l'instance compétente accréditée : la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNE CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS SE RAPPORTANT À L'ESCALADE GLACIAIRE
Une pratique d'abord liée à l'alpinisme, le début de la particularité peut se situer :
- En Écosse, en 1970, les progrès du matériel et des techniques, et l'audace des protagonistes, vont transformer complètement les façons de faire des alpinistes.
- En France, en 1975, avec l'escalade de cascades de glace et de goulottes, et après les progrès du matériel, crampons et piolets venus d'Écosse.
La compétition d'escalade glaciaire
Depuis 1998, on assiste à un intérêt notable pour une forme de compétition d'escalade glaciaire, sur structures naturelles et artificielles.
Un équipement de premier ordre, que possède la commune de Champagny-en-Vanoise, permet cette pratique sportive hivernale sur structure artificielle, qui peut s'envisager aussi comme un loisir sportif de mi-décembre à mi-mars.
Une structure artificielle constituée d'une tour aménagée couverte de glace, d'une hauteur de 24 m, et proposant des dévers de 15 m. Les ancrages de sécurité sont en place. Les grimpeurs utilisent crampons et piolets, des outils de plus en plus perfectionnés.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - ESSAI DE CHRONOLOGIE DE L'ESCALADE ROCHEUSE EN FALAISE
D'abord en Grande-Bretagne et en Allemagne, une discipline sportive en dehors de l'alpinisme.
Déjà en 1826, dans Lake District, un berger William Atkinson avait gravi Pillar Rock par « Old West Climb », parcours pouvant déjà s'apparenter à de l'escalade.
AU XIXeSIÈCLE
Année 1884 - Le premier escaladeur
Walter Perry Haskett est le premier grimpeur connu ; il est considéré comme le père de l'escalade britannique et mondiale. Il franchit seul et sans corde Needle Rigge sur Great Gable, dans la région de Lake District, au centre de l'Angleterre.
L'obstacle escaladé correspond au troisième degré de la graduation française des difficultés, qui sera proposée plus tard, et la corde est estimée être un moyen artificiel.
Haskett, qui réussira à la même époque plusieurs escalades notables, ne s'intéressera jamais à l'alpinisme.
Les Britanniques sont les premiers à proposer une escalade sportive, avec une éthique précise et sans relation avec l'alpinisme.
Année 1890 et avant - L'autre berceau
Premières escalades dans le massif de l'Elbsandstein, sur le bord de l'Elbe, dans la Saxe en Allemagne. Cet ensemble de tours de grès va devenir l'autre berceau de l'escalade sportive, là aussi au début presque sans relation avec l'alpinisme.
Année 1898 - Le quatrième degré
Owen Glynne Jones réussit avec un compagnon Pinnacle Face sur Scafell Grag, dans la région de Lake District, dans le centre de l'Angleterre.
La difficulté, qui ne commencera à être codifiée qu'en 1924 en Europe continentale, correspond au quatrième degré dans la graduation française en devenir et la corde fait partie du bon style.
DANS LES ANNÉES 1900
Année 1900 - L'exploration des Calanques
Création à Marseille d'un petit groupe informel - le Rocher Club de Provence - qui va se livrer à l'exploration des différentes tours, arêtes et sommets des Calanques, mais ce n'est pas encore de l'escalade, plutôt de la découverte.
Année 1903 - Déjà le très difficile
Une escalade exceptionnelle est réalisée avec Botterill's Slab, toujours dans Lake District, en Angleterre. La difficulté est du cinquième degré.
Année 1905 - Une éthique rigoureuse
En Allemagne dans le massif de l'Elbsandstein, début de l'escalade sportive, régie par des règles strictes proposées par Rudolf Fehrmann, basées sur l'idée que le grimpeur ne doit compter que sur ses propres forces. L'assurage se fait au moyen d'anneaux de corde et de nœuds coincés dans les reliefs naturels pour préserver la roche fragile en grès.
L'éthique rigoureuse est destinée à sauvegarder les possibilités ultérieures d'escalade libre. C'est un sport très populaire dans ce massif qui compte de nombreux adeptes.
- Le sixième degré
Dans le massif de l'Elbsandstein, première escalade présentant un obstacle du sixième degré de la graduation française des difficultés, qui ne sera proposée que plus tard.
L'exploit est réalisé par Olivier Perry-Smith et par Rudolf Fehrmann durant les premières ascensions de Teufelsturn.
Année 1908 - Le Groupe des Rochassiers
Dès 1908, peut-être 1906, des anciens des Caravanes scolaires de la Section de Paris du Club Alpin, commencent à fréquenter régulièrement les massifs de rochers de la forêt de Fontainebleau, dans le but de s'initier et de s'entraîner à l'escalade, ils se rassemblent au sein d'une entité informelle le « Groupe des Rochassiers »... Durant l'été dans les Alpes, ils entreprennent plusieurs ascensions et escalades rocheuses.
Année 1910 - Les principales avancées techniques viendront des Alpes orientales.
Elles seront liées aux grandes ascensions des parois calcaires des Alpes orientale (voir le dossier du CFD : Un historique de l'alpinisme de 1492 à 1914).
C'est à ce moment-là, avec l'utilisation des crochets de murailles (pitons) que les notions d'escalade libre et d'escalade mixte et artificielle commenceront à être évoquées.
Année 1911 - La polémique concernant les moyens
En cette année 1911 paraît dans le titre Deutscher Alpenzeitung, sous la plume de Paul Preuss, l'article clé concernant les moyens de l'escalade. C'est le début de l'immense polémique sur l'utilisation de moyens artificiels en escalade (voir le dossier du CFD : Un historique de l'alpinisme de 1492 à 1914).
Le matériel du grimpeur jusqu'en 1914
En 1908, l'équipement des grimpeurs est sommaire, la corde en chanvre, espadrilles de corde ou d'étoffes dans les ascensions rocheuses, l'encordement est direct à la taille.
Mais des techniques nouvelles vont profondément modifier les façons de faire.
- Les crochets de muraille
Les « crochets de muraille » - appelés aussi « crampons de fer » - sont des ancrages artificiels, des lames en acier, terminées par des anneaux, enfoncées à l'aide d'un marteau dans les fissures naturelles de la roche (les pitons en France).
Ils sont utilisés dès 1870, dans les Alpes orientales, pour amarrer les rappels permettant la redescente des raides parois des Dolomites, puis pour l'assurage et la progression. Ils auront une utilisation très confidentielle, seulement dévoilée en France dans les années mil neuf cent trente.
Les crochets de muraille ne seront pas admis, pour un temps, en Grande Bretagne, et acceptés suivant leur propre éthique dans le massif de l'Elbsandstein.
- Les mousquetons
En 1910, le Munichois Otto Herzog emprunte aux pompiers de Munich le mousqueton en acier qui permet la liaison commode entre le crochet de muraille et la corde. Dès 1913, un magasin spécialisé de Munich propose déjà ces mousquetons à la vente.
- Les manchons
Hans Kresz chausse pour la première fois dans les Dolomites des espadrilles à semelle de feutre, les fameux manchons.
Les espadrilles renforcées des Dolomites, les Kletterschuch sont en usage en France dès 1908… Les manchons suivront.
- Les rappels de corde
Le rappel de la corde, pour faciliter la descente, avait été inventé par Edward Whymper, dans les Alpes occidentales dès 1864. Mais en utilisant la seule force des bras, le procédé restera très archaïque.
Bientôt les rappels de corde seront employés pour la descente des reliefs calcaires très raides des Alpes orientales, en recherchant un moyen de freinage, comme la technique très aléatoire de la « Kletterschluss », à l'aide de la jambe et les pieds. Viendra un premier progrès, avec la méthode genevoise, utilisant le bas du corps et un bras.
La technique du rappel en S, avec le freinage de la descente, par le frottement du corps, beaucoup plus sécurisante, sera développée par Hans Dulfer avant 1914, la « Dülfersitz ». Cette technique de descente à la corde restera utilisée jusqu'à la commercialisation de l'outil en forme de huit et du baudrier, dans les années mil neuf cent soixante-dix.
Parallèlement, Hans Fiechtl propose une méthode de progression, la traversée à la corde.
Année 1914 - Scafell's Central Buttress
C'est encore une performance de premier ordre qui est réussie par Siegfried Herford, avec l'escalade de Scafell's Central Buttress, toujours dans Lake District, qui est le terrain de jeu principal des Iles Britanniques.
La difficulté correspond au cinquième degré, en respectant bien entendu l'éthique britannique : pas de piton, pas de point d'aide…
Année 1918 - Un exploit en avance d'au-moins une génération
Il est réalisé dans l'Elbsandstein, en Allemagne par Emanuel Strubich et Arno Sieber, sur l'arête ouest de Wilder Köpf. C'est un exploit en avance d'au-moins une génération (6b, dans la graduation utilisée aujourd'hui en France).
Il faut redire ici que les falaises de l'Elbe et de Lake District ont été les sites précurseurs de l'escalade sportive.
Année 1919 - Le G.H.M.
Issu du Groupe des Rochassiers, c'est la création du Groupe de Haute Montagne, et la naissance d'un alpinisme français sportif et élitiste.
DANS LES ANNÉES 1920
Année 1923 - La recherche d'une évaluation des difficultés
- Des réclamations et des demandes, pour obtenir des descriptions et des évaluations précises des ascensions, figurent dans la revue du Club Alpin La Montagne : « cela rendrait de grands services particulièrement aux sans guides ».
Dans les relations des itinéraires qui commencent à être publiées, il apparaissait un embarras certain pour situer la difficulté d'un itinéraire ou d'un passage d'escalade.
Les évaluations se font par des formules diverses et variées : difficulté suprême, supérieure, extrême, considérable, importante, appréciable, fatigante, sérieuse, insignifiante, etc. totalement approximatives et ambigües.
Les premiers guides Vallot-Fischbacher de 1925 à 1937 auront recours à ces formulations qui ne pourront que provoquer perplexités et embarras.
La description des itinéraires et l'évaluation des difficultés seront les deux éléments principaux qui permettront l'essor de l'alpinisme sportif et autonome…
Et déjà des propositions sont suggérées, pour instaurer une échelle de difficultés, destinée à obtenir une classification des ascensions, soutenue par une comparaison avec des itinéraires connus de référence.
Le Groupe de Haute Montagne va largement œuvrer à développer l'information alpine et va chercher à aller vers une clarification.
Année 1924 - Une échelle des difficultés
En 1924, Willo Welzenbach propose une évaluation des difficultés des escalades rocheuses par une échelle en six degrés, s'inspirant des notations pédagogiques germaniques en cinq degrés, avec un sixième degré représentant la limite des possibilités humaines.
C'est une graduation basée sur la comparaison avec des escalades de référence, elle sera désormais utilisée pour situer les difficultés dans les Alpes orientales.
Les articles de Dominico Rudatis, dans la revue Alpinismo (1929) et dans l'Annuaire du Club Alpin Académique Italien (1927-1931), viendront soutenir cette proposition.
Année 1927 - L'arête de Marseille
Deux cordées se retrouvent par hasard au pied de l'arête ouest de la Grande Candelle, dans les Calanques de Marseille. La cordée autochtone comprend Jean Laurent et Ernest Wyss, qui avaient déjà reconnu la partie supérieure en rappel, et les Parisiens de l'école de Fontainebleau Hugues et Maurice Paillon.
Ils unissent leurs efforts, emmenés par Hugues Paillon, pour réaliser la première ascension de l'arête de Marseille, qui deviendra l'escalade la plus célèbre des Calanques (dans la longueur du départ, quelques coins de bois étaient en place, signe d'une tentative précédente, et quelques baragnes facilitaient la progression).
C'est une incursion isolée de l'escalade difficile dans les Calanques, qui en est encore à l'ère de la découverte, pas tout à fait encore dans celle de l'escalade sportive.
DANS LES ANNÉES 1930
Création des écoles d'escalade en falaise préparatoires à l'alpinisme.
Année 1930 - Les Ardennes belges
Les alpinistes belges, en premier lieu le roi Albert 1er, alpiniste notoire, qui fréquente régulièrement les Dolomites, trouvent dans les Ardennes belges des falaises rocheuses propices à l'entraînement physique et à la préparation technique.
C'est le début de l'exploration des falaises de Freyr, sur les bords de la Meuse, avec marche en cordée, assurage, etc.
C'est aussi l'apparition des pitons et mousquetons pour l'escalade en falaise (voir le dossier du CFD : Le matériel de l'alpiniste).
L'emploi des pitons ramené des Dolomites permet des itinéraires audacieux.
C'est le roi Albert qui a fait fabriquer les premiers ancrages utilisés…
Année 1932 - Les Calanques
Début de l'exploration des falaises des Calanques de Marseille, à des fins d'escalade, notamment par Henry Barrin et Charles Magnol et plus tard Georges Albert.
- Les révélateurs des nouveaux matériels
Jusque-là, l'utilisation des nouveaux matériels, venant des Dolomites et des Alpes orientales, facilitant beaucoup les ascensions, était restée dans la confidence des initiés…
En 1932, un article d'Alain Leray paraît dans La Montagne. L'auteur présente pour la première fois en France une information sur l'utilisation des pitons et des mousquetons en escalade.
En 1933, Raymond Gaché, toujours dans La Montagne, note « En ce moment nous assistons à l'introduction en France des méthodes dolomitiques avec leur arsenal d'étriers, de pitons à rocher et à glace, de mousquetons, de marteaux ».
Année 1933 - Au-delà du sixième degré
Dans le massif du Rätikon, sur la frontière austro-suisse, E. Burger, K. Bizjak et F. Matt escaladent la face sud du Gross Drusenturn.
Le passage clé - une fissure surplombante - n'est répété qu'en 1979 (6b).
- Le Spigolo de l'Al'legne
Dans les Ardennes belges, première ascension du Spigolo de la falaise de l'Al'legne à Freyr, le roi Albert était dans les tentatives et fera une répétition de l'itinéraire durant la même année.
L'escalade atteint sur les bords de la Meuse un haut niveau technique, en avance sur tout ce qui se fait en France, hormis bien sûr l'escalade de blocs à Fontainebleau.
Année 1935 - La Directissime de l'Al'legne
Dans les Ardennes belges, escalade du grand dièdre principal de la falaise de l'Al'legne à Freyr, la Directissime qui deviendra la voie la plus classique du massif. La difficulté abordée est le cinquième degré, les pitons ne servant normalement que comme points d'assurage.
- Le retard des Parisiens
Première sortie collective d'escalade, organisée par la Section de Paris du Club Alpin, vers les falaises des Ardennes belges « et rares sont ceux qui se risquent en tête ». Les Parisiens vont pouvoir mesurer le retard qu'ils ont accumulé dans la technique de l'escalade difficile en falaise ; comme l'emploi des pitons, la marche en cordée et l'adaptation à la verticalité et à l'exposition.
- Les falaises aux USA
Fritz Wiesser en émigrant en Amérique, apporte le savoir-faire et l'éthique rigoureuse - sans usage des pitons - de l'escalade saxonne.
C'est dans le massif des Shawangunks, sur la côte est des USA, le début de l'escalade en falaise.
Hans Kraus, un transfuge des Alpes orientales, apportera l'utilisation des pitons.
La polémique sur l'utilisation des pitons gagne le Nouveau Monde.
- Une double échelle des difficultés
En 1935, Lucien Devies propose un double système de cotation de l'ensemble des difficultés d'un itinéraire rocheux, basé sur des comparaisons avec des ascensions de référence et applicable dans nos Alpes occidentales.
Une première échelle informe sur des différents obstacles à gravir en six degrés d'un itinéraire, elle est directement inspirée du système Welzenbach, c'est l'évaluation d'un passage d'escalade.
Une seconde échelle apprécie l'ensemble d'une ascension allant du « facile » à « l'extrêmement difficile » en six degrés également, c'est l'estimation globale d'un itinéraire, allant du "facile" à "l'extrêmement difficile" en six degrés également... (voir le dossier du CFD : Un historique de l'alpinisme 1919-1939).
Une façon de "passer du vague au défini".
Aussitôt une belle polémique, animée par Etienne Bruhl, va enflammer le milieu alpin pendant quelque temps (lire les articles de La Montagne 1935 et 1936).
Lucien Devies, par des échanges épistolaires réguliers et rigoureux, chercha à stabiliser le système d'évaluation des difficultés de l'escalade, de 1935 et jusqu'en 1978. Son influence, comme corédacteur des principaux guides-itinéraires de montagnes de France, a été déterminante pour installer le système d'évaluation des difficultés de l'escalade rocheuse.
Il réussira à affermir le système, en établissant une série d'escalades de référence, acceptées par différents sachants - Guides et élite.
Un peu plus tard, une évaluation de la difficulté de l'escalade artificielle en quatre degrés (A1 à A4) est proposée...
Le tri commence à être fait entre escalade libre, mixte et artificielle.
- Dans les Calanques
Durant les congés de Pâques 1935, la Section de Paris du Club Alpin organise une sortie collective d'escalade, dans les Calanques de Marseille.
Année 1936 - La Barrin
Dans les Calanques, la voie aujourd'hui classique de la face nord des Goudes - la Barrin - est réussie par Henri Barrin et deux compagnons. Le niveau atteint est le cinquième degré, avec l'aide de pitons comme points d'assurage.
Année 1938 - Le cinquième degré supérieur
Avec Diagonal, ligne d'escalade de Llanberis Pass, dans le nord du Pays de Galles, c'est le cinquième degré limite supérieure qui est atteint, par Arthur Birtwistle, toujours suivant l'éthique rigoureuse des Britanniques.
- Dans les Calanques
Dans les Calanque, une voie difficile est inaugurée : La face ouest du Rocher des Goudes, par Roger Duchier et Charles Magnol avec l'aide des pitons.
Le mousqueton léger
Dès 1938, le mousqueton léger en alliage d'aluminium commençait à être imaginé et essayé par Pierre Allain. Il ne sera pas commercialisé, mais montrera plus tard sa justification.
Année 1939 - L'exploration du Saussois
Début de l'exploration du Saussois, une falaise du bord de l'Yonne en amont d'Auxerre, en s'assurant depuis le haut de la falaise, la ligne de moindre résistance de la Grande Roche est gravie par Georges Bonnaud et Maurice Martin, la voie nouvelle est appelée la Martine et présentera, avec deux points d'aide, une difficulté du quatrième degré supérieur.
DANS LES ANNÉES 1940
Année 1941 - La Rech au Saussois
Jean Bernardeau et Maurice Martin escaladent l'éperon principal de la Roche centrale du Saussois, avec assurage depuis le haut de la falaise.
Cet itinéraire va être la plus classique escalade de ce qui va devenir la célèbre école des Parisiens.
La voie est appelée la Rech, en hommage à A. Rech, l'un des trois « découvreurs » du Saussois avec Georges Bonnaud et Maurice Martin ; la voie présentera en bon style une escalade du cinquième degré, les pitons ne servent normalement que comme points d'assurage.
C'est le début de l'exploration des falaises du bord de l'Yonne.
Maurice Martin, par ses écrits et ses conférences, va contribuer à l'extraordinaire développement de l'escalade au Saussois. Ce qui aura de grandes conséquences dans l'amélioration des performances des grimpeurs parisiens dans l'escalade difficile, aussi bien libre qu'artificielle.
On grimpe protégé par la corde en chanvre, mousquetons en acier, encordement directement à la taille.
- L'escalade mixte et artificielle
Avec Georges Livanos et ses amis, apparition dans les Calanques des itinéraires de haute difficulté, avec une escalade à prédominance mixte et artificielle, qui va atteindre un niveau technique et athlétique élevé.
Année 1942 - La Martine au Saussois
Jean Mignon et Pierre de Poly gravissent, pour la première fois, la Martine au Saussois, en technique classique, c'est-à-dire sans assurage par le haut de la falaise. Pierre Leroux en réalisera l'ascension solitaire deux ans plus tard.
Dès cette année-là, la Martine, la Rech, l'Ancienne Traversée et l'Éclair vont être gravis en bon style, et devenir des ascensions classiques, avec l'assurage sur pitons.
Année 1943 - Une nouvelle école d'escalade
Parution d'un article dans la revue La Montagne : Une nouvelle école d'escalade, le Saussois, par A. Rech. Avec ce terrain d'entraînement de qualité, les grimpeurs parisiens vont rapidement être beaucoup plus à l'aise dans la conduite des escalades sportives…
La graduation-type des difficultés d'escalade rocheuse
En 1943, le GHM réunit une commission comprenant les compétences du moment : Allain, Charlet, Devies, Frendo, Jonquière, Laloue, pour définir des exemples de graduation-type de passages d'escalade rocheuse, et des exemples d'évaluation globale d'une ascension.
Une mise au point publiée par Lucien Devies accompagne les travaux de l'instance.
Le fameux VI sup des Dolomites, qui indiquait : soit une escalade libre difficile, soit une escalade mixte ou artificielle, soit encore un passage exposé et peu sécurisé, a vécu.
Année 1946 - L'Échelle à poissons
Après les assauts successifs de plusieurs cordées, la voie la plus emblématique du Saussois, l'Échelle à poissons, est gravie.
Année 1947 - La corde en polyamide
À la sortie de la guerre 1939-1940, apparaît la corde en polyamide.
Jusque-là, on grimpait avec comme seule protection la corde en chanvre, celle-ci cassait pour une chute libre d'un mètre, sous une charge de 80 kg, la sécurité pour le premier de cordée était inexistante.
Avec le polyamide (Nylon), le progrès est décisif… En 1947, la corde moderne va être proposée à tous (voir le dossier du CFD : Le matériel de l'alpiniste et du grimpeur).
Les cordes à double et à simple
Jusque-là, les cordées emportaient une corde supplémentaire, pour la descente en rappel, qui s'ajoutait par un nœud à la corde d'attache.
Bientôt les équipementiers vont proposer des cordes à double (9 puis 8 mm) permettant l'assurage pendant l'escalade, en utilisant les deux brins de la corde et la descente en rappel, sur une même longueur libre. Des cordes à simple sont proposées, pour l'assurage en falaise, sur un seul brin, au début avec un diamètre important (14, puis 12 mm, aujourd'hui 9 et jusqu'à 8,2 mm pour les plus techniques).
- La fissure d'Hortus
Georges Fraissinet escalade la fissure d'Hortus de la falaise homonyme. La difficulté est du cinquième degré limite supérieure, l'escalade, très exposée, restera quinze ans sans répétiteur.
- Les hauts lieux de l'escalade en falaise
L'escalade en falaise connaît un développement sensible. Les Ardennes belges, les Calanques et le Saussois sont les hauts lieux de cette discipline - préparatoire à l'alpinisme -, et à un degré moindre les sites de Saffres, de Cormot, du Baou et du Caroux.
La protection des grimpeurs est assurée par les pitons, qui servent souvent indifféremment de points d'assurage et de points d'aide.
Il va apparaître rapidement que les pitonnages et les dépitonnages successifs endommageaient sérieusement la roche, et principalement la roche calcaire, plus fragile que le granit. L'équipement à demeure, des voies fréquentées, deviendra vite une obligation, avec parfois des ancrages placés après forage de la roche.
Année 1948 - Le mousqueton léger en alliage d'aluminium
C'est encore le mousqueton en acier qui est utilisé.
Déjà en 1938, un mousqueton léger en alliage d'aluminium avait été essayé par Pierre Allain
En 1948, un mousqueton léger en alliage d'aluminium (Duralumin) est commercialisé par Allain, mais il devait être utilisé avec prudence, essentiellement pour l'escalade artificielle, car il ne résistait pas à une chute même modeste (voir le dossier du CFD : Le matériel de l'alpiniste et du grimpeur).
Ces mousquetons ne sont pas munis d'un tenon de verrouillage du doigt mobile, comme l'ont été depuis longtemps, par empirisme, les mousquetons en acier. L'amélioration n'apparaîtra que plus tard, avec les progrès de la science des matériaux.
- Les chaussons d'escalade
En 1948, et après une longue mise au point commencée en 1935, Pierre Allain introduit sur le marché, dans son célèbre magasin de la rue St Sulpice à Paris, un chausson d'escalade à semelle caoutchouc de marque PA.
Les fameux chaussons bleus seront immédiatement les équipements indispensables pour l'escalade à Fontainebleau.
Ils seront un moment utilisés en falaise et en montagne par des initiés, comme en 1953 les frères Henry et Pierre Lesueur, durant l'ascension par l'arête nord-est de la dent du Caïman. Mais les chaussures à semelles Vibram, plus commodes et plus confortables en escalade mixte et artificielle, seront ensuite préférées pendant un moment.
Les chaussons PA resteront, en France, réservés, à quelques exceptions près, aux blocs de Fontainebleau durant encore quinze ans.
En 1955, ces chaussons sont adoptés pour l'escalade des parois des Îles Britanniques.
En 1955, sur les falaises, on grimpe en chaussons à semelle de crêpe, puis en chaussons PA, et rapidement en chaussures à semelles Vibram. Un modèle de chaussure légère à semelle Vibram sera proposé en 1953.
DANS LES ANNÉES 1950
Les pitons offrent des possibilités presque sans limites.
Année 1950 - L'Ange du Saussois
Lucien Berardini, avec un compagnon, force un itinéraire nouveau - l'Ange -, directement dans les extraordinaires bombements de la Grande Roche du Saussois, en escalade artificielle bien sûr. C'est la voie la plus difficile du massif, avec une grande difficulté de pitonnage.
Année 1951 - Le topo du Saussois
Édition du Guide des escalades au Saussois, en tirage provisoire, un premier guide-itinéraires concernant ces falaises, par Maurice Martin.
Année 1952 - La directe 1952
Dans le massif des Calanques, Georges Livanos et ses compagnons inaugurent, avec la Directe 1952, une voie nouvelle dans la face sud de Saint-Michel d'Eau Douce. On atteint dans les Calanques, avec cette technique mixte et artificielle un paroxysme, les grimpeurs sont capables de passer partout.
- Déjà une économie de moyens
Les grimpeurs du Saussois cherchent à limiter l'emploi de l'escalade artificielle. Le Jardin suspendu, ouvert par Lucien Berardini avec différents compagnons, en utilisant quelque trente pitons, est rééquipé pour l'escalade libre avec neuf pitons seulement, la difficulté est du sixième degré avec deux points d'aide.
C'est le début des escalades difficiles en escalade mixte, du libre avec l'aide des pitons dans certains passages, le tire-clou...
- Cenotaph Corner
Joe Brown réalise le fameux Cenotaph Corner à Llanberis Pass, dans le nord du Pays de Galles.
C'est le sixième degré de difficulté, avec les règles très strictes de l'escalade britannique.
Année 1953 - Un guide d'escalade
En 1953, Maurice Martin fait paraître un guide des escalades du Saussois.
Année 1955 - La fissure de Surgy
Michel Grassin escalade la fissure de Surgy sans protection, difficulté du sixième degré, très exposée (dans la graduation française en devenir), elle ne sera reprise qu'après équipement de points d'assurage en 1965.
Année 1958 - Le mousqueton léger
Pierre Allain est le premier à proposer un mousqueton léger à haute résistance mécanique en alliage léger (Zicral), toujours sans tenon de verrouillage du doigt mobile. Ce nouveau matériel annonce le mousqueton moderne, avec un poids de 50 g et une résistance à la traction de 1600 daN, avant l'avancée technique de 1966 (voir le dossier de CFD : Le matériel de l'alpiniste et du grimpeur).
Le mousqueton léger en alliage d'aluminium va de généraliser, avec les progrès des alliages proposés, et des facteurs de forme améliorés.
DANS LES ANNÉES 1960
L'économie de moyens entre les ancrages, l'époque du « tire-clou ».
Année 1960 - Les coinceurs
Première utilisation des coinceurs par les Britanniques, sur les falaises du Snowdon, dans le Pays de Galles.
Une solution élégante pour l'assurage en coinçant, dans les fissures naturelles de la roche, des pierres ou des cailloux, puis des petites pièces de métal - d'abord des boulons - reliées à des anneaux de corde. Ils façonneront ensuite des outils plus adaptés, les coinceurs.
L'emploi de ce moyen d'assurage va se répandre rapidement dans les Iles Britanniques (voir le § : 1969 - L'apparition des coinceurs en France, et le dossier du CFD : Le matériel de l'alpiniste et du grimpeur).
Les coincements de pierres, dans certaines fissures naturelles de la roche, ont rapidement intéressé les grimpeurs britanniques, permettant un ancrage de protection solide, entouré par un anneau de corde, et conforme à leur refus des pitons. Une façon de faire souvent confidentielle.
Année 1962 - L'équipement en question
Dans les Ardennes belges et au Saussois, l'équipement des voies d'escalade évolue vers une économie de pitons, avec une escalade difficile entre les ancrages éloignés, qui servent souvent et indifféremment de point d'aide, d'assurage ou d'arrêt.
Dans les Calanques, on commence à équiper à demeure les relais et certaines lignes d'ascension.
- Les noms des voies
C'est à ce moment que des noms, éloignés de toute logique, sont proposés pour désigner les voies d'escalade des falaises.
Des noms qui seront choisis suivant les fantaisies - parfois inspirées mais pas toujours - des ouvreurs, d'abord pour les falaises de Connelles, en bord de Seine.
Les pitons américains et les coins de bois
Les pitons classiques en acier malléable sont largement diffusés et font partie de la panoplie des grimpeurs, avec le marteau pour les enfoncer.
En 1962, les pitons américains - en acier spécial, raide et très élastique - traversent l'Atlantique, ils sont très bien adaptés au granite, sont facilement utilisables, réutilisables et récupérables. Ils ont été inventés et utilisés par John Salathé, pour l'ouverture de Lost Arrow dans le Yosemite en 1946.
C'est l'apparition des Bongs, des Leepers, des Angles et autres Rurps…
Les pitons classiques conservent cependant leurs avantages dans les parois calcaires en préservant l'intégrité de la roche.
Notons l'utilisation occasionnelle de coins de bois pour sécuriser les passages de fissures larges, avant l'arrivée des pitons américains. Un moyen de protection qui interpelle, encore aujourd'hui, par son utilisation fantasmé.
Il offrait une très bonne sécurité, lorsqu'une sangle ou un anneau de corde encerclait entièrement l'objet, la cordelette d'attache ne servant qu'au transport !
Année 1964 - L'escalade libre
Avec François Guillot et ses amis, apparition dans les Calanques des itinéraires de haute difficulté, avec escalade à prédominance libre, comme par exemple la Gamma dans le massif d'En Vau.
- L'économie de pitons
Les progrès de l'escalade libre vont se faire par l'économie de pitons. Le jeu va être de n'en utiliser qu'un minimum pour réaliser une escalade. Mais l'usage du piton est mal précisé, les trois fonctions sont confondues : assurage, aide et repos.
- La propagande de Claudio Barbier
Claude Barbier, qui était l'un des meilleurs rochassiers de sa génération, sera le premier propagandiste en Europe continentale et occidentale d'une escalade libre et propre, il a visité l'ensemble des massifs d'escalade d'Europe, et connaît bien les règles sportives des écoles est-allemande et britannique, très critiques sur les moyens artificiels.
Rapidement convaincu que le paroxysme atteint par le « règne du fer » conduisait à une impasse, le grimpeur belge fera une diffusion discrète, mais continue des idées venues de Grande-Bretagne et des bords de l'Elbe. Sa grande notoriété servira à faire bouger les choses. Et plus tard, il sera également très actif pour propager le recours aux coinceurs.
Année 1965 - L'équipement en question
Sur les falaises du Saussois et des Ardennes belges, dans les Calanques, on commence à mettre en place des pitons scellés, ou des ancrages implantés après forage de la roche, aux relais et aux points névralgiques des escalades classiques.
En particulier dans les rochers de Surgy, Guy Richard se livre à un équipement général des voies, avec une implantation réfléchie des points d'ancrage, placés en rappel.
Dans les Calanques, on commence à équiper à demeure les relais et certaines lignes d'ascension.
- L'escalade en jaune
Claudio Barbier cherche à faire évoluer l'escalade dans les falaises des Ardennes belges. La Directissime de la falaise de l'Al'legne, une des plus classiques et des plus belles escalades de Freyr, est à l'évidence surpitonnée, et beaucoup utilisent les ancrages comme points d'aide… « le tire-clous »…
Pour ne pas provoquer de polémique, Barbier a l'idée de différencier, avec de la peinture jaune, les ancrages qui ne devaient seulement servir que de points d'assurage, contrairement aux autres points d'aide ou de repos. Petit à petit, l'expression « jaunir une voie » va devenir synonyme d'escalade libre, mais cette proposition restera marginale, pour encore un peu de temps.
Et le tire-clou aura encore de belles années devant lui.
- Les falaises de l'Elbsandsteingebirge
En 1966, Claudio Barbier propose la traduction d'un article « L'Elbsandsteingebirge » d'Herbert Richter, dans La Montagne & Alpinisme. Ce sera une vraie stupéfaction pour beaucoup.
- Les ancrages forés
Le forage de la roche, pour placer un ancrage, a été longtemps l'arme interdite en escalade.
Avoir recours à un seul piton-gollot, dans une paroi de 1000m, vous exposait à l'équivalent d'une excommunication…
Déjà les gollots de la face ouest des Drus avaient été très critiqués en 1952…
En 1958, les Américains sont les premiers à effectuer systématiquement des forages de la roche pour placer des pitons-gollots ; les ancêtres des « Spits » et autres « Rings ».
Bientôt dans les Dolomites, on attaque les parois là où elles sont les plus surplombantes, avec des longueurs de corde entièrement mixtes ou artificielles et utilisation de nombreux pitons-gollots.
Sur les falaises d'escalade, les relais puis les itinéraires verront peu à peu un équipement par des ancrages forés.
Redisons que le pitonnage et de dépitonnage de la roche calcaire provoquent des dégâts irrémédiables, également pour le granite, comme il sera constaté dans le Yosemite, avec l'usage des pitons en acier spécial.
Année 1966 - Le mousqueton moderne
En 1966, le mousqueton en alliage léger, avec verrouillage du doigt d'ouverture, est présenté par Pierre Allain. C'est un véritable élément de sécurité. C'est à ce moment-là, avec la compréhension du système mécanique du dispositif, qu'est apparue l'importance du verrouillage du doigt de fermeture du mousqueton, comme déjà en place par empirisme, sur les mousquetons en acier (voir le dossier du CFD : Le matériel de l'alpiniste et du grimpeur ).
Des fabrications similaires seront bientôt proposées par les autres fabricants.
Année 1966 - La classification des difficultés de l'escalade rocheuse
En 1966, l'Assemblée générale de l'Union internationale des Associations d'Alpinisme (UIAA) avait proposé l'adoption générale du système Welzenbach de classification des difficultés en six degrés d'un passage d'escalade rocheuse, en décidant en plus, et malheureusement, que le précepte a une limite, le VI supérieur.
C'est-à-dire qu'il est fermé, alors que depuis longtemps, pour les escalades de blocs et en falaise, une autre évaluation était utilisée qui, au-dessus du sixième degré, permettait de prendre en compte l'évolution de l'escalade.
L'utilisation de chiffres romains est préconisée dès les parutions des guides-itinéraires du massif des Écrins de 1946 et Vallot-Arthaud de 1947, et dans les ouvrages italiens.
Elle le sera jusqu'en 1978.
Année 1967 - Évolution par dépitonnage
Au Saussois, la Super-Échelle est équipée avec une économie de points d'aide, mais le piton reste indifféremment utilisé comme point d'aide ou d'assurage, c'est encore l'époque du "tire-clous".
- Les chaussons d'escalade
Depuis 1948, les fameux chaussons bleus PA aux semelles de caoutchouc étaient l'équipement indispensable pour l'escalade à Fontainebleau.
Seuls des initiés avertis utilisaient les chaussons PA en falaise et en montagne.
En 1955, ces chaussons avaient été adoptés pour l'escalade des parois des Îles-Britanniques…
En 1963, le modèle d'origine échappe à son inventeur Pierre Alain et sera récupéré par son fabricant-cordonnier Bourdonneau qui proposera le chausson bleu d'origine, mais sous sa propre marque, avec le sigle EB super-gratton.
En 1967, les chaussons d'escalade, maintenant EB, font leurs apparitions dans les falaises, et aussitôt dans les escalades rocheuses des Alpes, permettant bientôt des progrès notables.
Et, à partir de 1974, les chaussons EB et leurs dérivés seront indispensables pour toute escalade rocheuse difficile ou pas, en tous lieux.
Dans le même temps les grimpeurs américains sont venus constater en Grande Bretagne les avantages des chaussons devenu EB.
On lira un historique dans le paragraphe : École de blocs, école de Bleau / Année 1948 - Les chaussons d'escalade PA.
Année 1968 - Une découverte du Verdon
Les parois des gorges du Verdon avaient été repérées depuis plusieurs années par les grimpeurs marseillais, mais leur intérêt s'était focalisé sur les falaises de Saint Maurin et de Mayreste, situées à l'entrée des célèbres gorges. Le plus brillant et entreprenant d'entre eux François Guillot avait encouragé Patrick Cordier et ses amis parisiens à visiter les lieux...
Ceux-ci, en août 1968, découvrent un rempart de plusieurs kilomètres de falaises inexplorées. Au lieu de tenter les lignes les plus prometteuses, ils s'arrêtent devant la face la plus haute et la plus incertaine, la paroi du Duc. La voie des Enragés sera ouverte en technique de siège, corde fixe et tamponnoir par Patrick Cordier, Patrice Bodin, Lothar Moch et Patrick Richard.
La grande histoire de l'escalade dans les gorges du Verdon pouvait commencer…
Et l'exploration pourra être reprise dans le bon sens, par François Guillot et ses amis, en commençant par les grandes lignes classiques ouvertes en bon style, avant que les ancrages scellés après forage de la roche ne viennent changer la donne.
- Le mur d'escalade
Le mur artificiel en briques, pour l'entraînement à l'escalade, est régulièrement utilisé en Grande-Bretagne, notamment dans les collèges.
Année 1969 - L'apparition des coinceurs en France
En 1960, première utilisation des coinceurs - les nuts - par les grimpeurs sur les falaises du Snowdon, dans le Pays de Galles
Les Britanniques, qui s'interdisaient, le plus possible, l'utilisation de pitons, avaient parfois recours à des coincements de pierres et de cailloux dans les fissures naturelles de la roche, comme moyen de protection, ils vont trouver une solution élégante pour l'assurage, en bloquant des petites pièces de métal - d'abord des boulons - reliées à des anneaux de corde. Ils façonneront ensuite des outils plus adaptés, les coinceurs.
Comme deja dit, les coincements de pierres, dans certaines fissures naturelles de la roche, ont rapidement intéressé les grimpeurs britanniques permettant un ancrage de protection solide, entouré par un anneau de corde, et conforme à leur refus des pitons. Une façon de faire souvent confidentielle, comme en 1954 sur la face ouest de l'Aiguille de Blaitière, où le recours à cet artifice n'avait pas été rendu public.
L'emploi de ce moyen de protection va se répandre... d'abord dans les Iles Britanniques.
Dès 1965, un constat inquiétant est fait aux USA, concernant l'usage des pitons en acier spécial. Ils détériorent le rocher, certaines fissures du Yosemite sont irrémédiablement abimées… Nos collègues américains viendront en 1967 chercher une issue dans les Iles Britanniques, avec l'emploi des coinceurs.
- L'utilisation des coinceurs en Europe continentale
En 1969, Claudio Barbier sera l'un des premiers propagandistes de ce nouvel outil en Europe continentale, et aussi utilisateur, en inaugurant la voie du Dragon dans les Dolomites, avec assurage sur coinceurs.
Utilisés dans les Alpes dès 1969, les coinceurs verront leurs formes s'améliorer avec les fameux Hexentrics, Stoppers, Bicoins, Titons et autres Copperheads.
En plus de son élégance, ce moyen de protection permet souvent de réduire l'exposition de l'escalade, mais en transformant certains grimpeurs en panoplie complète…
Il faudra attendre l'article de Patrick Cordier dans la revue La Montagne & Alpinisme n°2/1974, puis l'article d'Henri Agresti dans LM&A n°2/1977, pour que l'information soit complète en France, au regard des nombreux articles des publications anglo-saxonnes.
L'usage des coinceurs, proposé en Grande Bretagne en 1960, apparu dans les Alpes en 1969, se généralise en 1975 (voir le dossier du CFD : Le matériel de l'alpiniste et du grimpeur).
Notre titre reviendra sur l'aspect technique d'utilisation de ces nouveaux outils, avec un article de Jean-Claude Droyer en 1978.
DANS LES ANNÉES 1970
Vers l'escalade de haut niveau, et vers une éthique sportive.
Année 1970 - Le septième degré
La première escalade, correspondant à ce qui sera le septième degré (dans la graduation française en devenir), est réussie par John Stannard, avec la fissure Foops dans le massif des Shawangunks, aux USA.
Les Américains adoptent une éthique rigoureuse, les pitons sont exclus sur certaines falaises des Gunks.
Année 1972 - Supercrak
Dans le massif des Shawangunks aux États-Unis, Steve Wunsch ouvre la célèbre Supercrack. Une fissure qui sera ultérieurement classée 7c (dans la graduation française en devenir), marquant une avancée notable dans le savoir-faire des escaladeurs.
L'avance des Américains, dans l'escalade libre difficile, est conséquente.
- L'Ange partiellement en libre
Au Saussois, la voie de l'Ange est équipée de scellements éloignés, avec escalade difficile entre les ancrages, par Patrick Cordier et Jean Fréhel. Le grand exercice d'escalade artificielle et de pitonnage, des années cinquante, devient une grande escalade libre... entre les points de repos, c'est-à-dire sans aucune continuité.
- Professionnel de l'escalade
Henry Barber, qui observe les règles rigoureuses de l'escalade libre, est le premier à consacrer une activité complète à cette discipline.
- Une éthique pour l'escalade
Aux États-Unis, c'est l'adoption des règles strictes : assurage sur coinceurs, voies engagées ; et dans certains sites, refus des ancrages scellés après forage de la roche.
Année 1973 - L'assurage
Dans un article consacré, notre revue LM&A montre encore l'assurage à l'épaule comme une solution, mais à proscrire dès qu'il y a risque de chute importante. Seul le demi-cabestan survivra aux progrès qui viendront en 1975, avec le baudrier d'encordement moderne et l'outil en forme de huit.
Année 1974 - Le septième degré en Grande-Bretagne
En Grande-Bretagne, les avancées dans l'escalade sont significatives. C'est Right Wall à Dinas Cromlech qui est gravi, par Pete Livesey.
La difficulté correspond à ce qui sera le septième degré (dans la graduation française en devenir). Les Britanniques ont, bien entendu, leur propre échelle des difficultés, différente de celle préconisée par l'UIAA et de celle qui sera adoptée en France.
L'éthique est beaucoup plus rigoureuse qu'en Europe continentale, la règle est l'escalade à vue et placement de points d'assurage, mais le passage peut être reconnu en rappel avant la tentative.
- Les Deux Aiguilles
Dans le secteur des Deux Aiguilles de la montagne Sainte-Victoire, Christian et Martine Guyomar et Christian Hautecoeur réalisent une série d'itinéraires nouveaux de haute difficulté. Une ligne d'ascension exceptionnelle - Ovni - reste la marque de ces précurseurs (6c dans la graduation française en devenir), elle est aujourd'hui protégée par des rings (remplaçant les improbables plombs et fils de fer), toujours bien espacés il est vrai...
Les voies majeures réussies par Guyomar et Hautecoeur sont réalisées en cordée classique, sans utilisation d'ancrages scellés après forage, les escalades sont souvent très exposées, et on a recours à des accessoires, tel le crochet à goutte d'eau (qui permettra certaines audaces), le plomb et le fil de fer.
Les lignes nouvelles sont d'abord explorées depuis le pied de la falaise, avec des moyens artificiels si nécessaire, puis peu à peu rendues à l'escalade libre, protections (parcimonieuses) en place.
C'est le début en France de l'escalade pratiquée quotidiennement. Le niveau sportif va s'élever considérablement devenant, pour les meilleurs, difficilement compatible avec une activité professionnelle à plein temps.
Année 1974 - Les chaussons
En 1974, les chaussons d'escalade du type Pierre Allain, devenu la marque EB, et ses dérivés deviennent les équipements indispensables pour toute escalade rocheuse difficile ou pas, en tous lieux…
Année 1975 - Les éléments de sécurité
- Le baudrier
Le premier baudrier d'encordement moderne est mis au point en 1970, par Don Whillans en Grande-Bretagne.
Dès 1975, le « baudrier Whillans » est disponible en France et les fabricants du continent ne tarderont pas à proposer leurs modèles.
C'est la généralisation du baudrier moderne comme moyen de sécurité en escalade. Jusque-là, les grimpeurs s'encordaient à la taille directement avec la corde, sauf pour les escalades artificielles, en fabriquant eux-mêmes un baudrier rudimentaire, ou dès 1963 en utilisant des harnais réservés à cet effet, mais encore peu adaptés, proposés par les fabricants.
- L'outil en forme de huit
Les Écossais ont eu les premiers la bonne idée d'améliorer le descendeur Allain en forme de fourche, et dès 1968 « l'outil en forme de huit », utilisable par tous, était proposé pour les rappels.
En fermant la fourche du descendeur Allain, ils obtenaient d'une bien plus grande sécurité, petite modification, grande conséquence, mais l'instrument se révélera bien plus qu'un descendeur…
Il faudra quelques années pour que l'engin traverse la Manche.
En 1975, l'outil en forme de huit et le baudrier deviennent les éléments essentiels de la sécurité pour l'assurage et la descente en rappel et l'assurage.
- Les méthodes d'assurage
Jusque-là, l'assurage du compagnon se faisait en passant la corde derrière l'épaule « l'assurage à l'épaule » ou encore avec le nœud de demi-cabestan, l'outil en forme de huit facilitera beaucoup les manœuvres de corde.
Plus tard, avec le développement de l'escalade sportive, de nombreux outils seront proposés améliorant la sécurité, avec le même objectif, permettre la libération rapide de la corde pour ne pas gêner le leader et être capable de parer efficacement la chute. Le Grigri sera l'outil le plus adapté et le plus utilisé pour les escalades d'une seule longueur de corde. Différentes plaquettes-freins d'assurage apparaîtront, plus adaptées aux grandes parois.
- Les rappels
Le rappel de corde restait une opération délicate et peu agréable avec la technique en S. Très peu d'alpinistes utilisaient le descendeur Allain en forme de fourche, mais l'incorporation d'un frein intermédiaire, entre l'homme et la corde, venait à l'esprit de tous. Pour les descentes techniques, les grimpeurs avertis utilisaient souvent un jeu de mousquetons croisés faisant office de frein et un baudrier de fortune, puis différents intermédiaires mécaniques, plus ou moins adaptés, seront proposés… Avec le huit et le baudrier, les alpinistes ont un ensemble de sécurité, permettant les rappels les plus vertigineux.
Le rappel - hier nécessitant des précautions techniques - devient avec l'outil en forme de huit et le baudrier un acte technique banal de descente.
- L'équipement moderne complet
En 1975, avec l'équipement moderne complet : le baudrier, la corde, les mousquetons modernes, et l'assurage au huit ou avec un demi-cabestan, les grimpeurs auront à leur disposition une chaîne de sécurité adaptée.
La chute - hier aux effets souvent désastreux - devient une conséquence plus acceptable, et le développement de l'escalade sportive à venir viendra presque totalement la banaliser.
- L'escalade libre en France
Les démarches de Claudio Barbier dans les Ardennes belges depuis 1965, dans le but de propager l'escalade libre, vont être entendues.
Jean-Claude Droyer - de retour des Îles Britanniques et des États-Unis - a pu constater l'évolution et les avancées réalisées par nos voisins, il sera l'initiateur en France d'une redéfinition des règles de l'escalade sportive et des habitudes des grimpeurs. Déterminé et extrêmement tenace, il va réussir à ébranler la lourde inertie des habitudes françaises.
Les ancrages ne doivent être utilisés que comme point d'assurage, et non plus comme trop souvent de point d'aide... c'est la révolution...
Dans les falaises du Baou de Saint-Jeannet, Patrick Berhault ; dans celles de la Montagne Sainte-Victoire, Christian Guyomar ; dans celles des Calanques, François Guyot ; dans celles du Verdon, Patrick Berhault, François Guyot et Bernard Gorgeon conduiront les mêmes avancées, mais avec des façons beaucoup moins « abruptes ».
Et à leur tour, les auteurs de ces évolutions ne tarderont pas à être abasourdis et « étonnés » par une nouvelle génération de grimpeurs qui viendra bientôt les surpasser.
Et les falaises de Buoux et du Verdon deviendront la vitrine d'un nouveau savoir faire qui se généralisera en France, avec les ancrages artificiels en place.
Un long article assez pertinent « L'escalade vers quel avenir » paraîtra dans La Montagne & Alpinisme n°1/1979, signé par Droyer et Michèle Gloden.
- L'utilisation des ancrages
Ces différentes initiatives vont amener à une prise de conscience en France concernant les trois utilisations possibles d'un ancrage : point d'aide, point de repos et point d'assurage.
L'escalade libre impose le refus de tout point d'aide ou de repos, l'éthique devient plus rigoureuse.
Une façon de faire plus précise sera favorisée par l'utilisation des coinceurs. L'assurage avec ce type de matériel permet une économie très grande de pitons et de pouvoir gérer son exposition.
Mais deux types de performances subsistent : l'escalade libre intégrale où il faut placer soi-même les points d'assurage et l'escalade libre sécurisée avec ancrages en place.
- En Allemagne
À peu près à la même époque en Allemagne, Kurt Albert se livre à la même analyse et à la même recherche de l'escalade libre dans les voies difficiles et artificielles. Les voies ainsi « libérées », c'est-à-dire gravies sans l'aide des ancrages, sont marquées à leur pied d'un point rouge (Rotpunkt ou RP).
Année 1976 - Le septième degré féminin
Une Américaine Barbara Devine réussit l'escalade de la fissure Foops dans les Gunks, aux U.S.A.
C'est une première féminine pour ce qui sera ultérieurement le septième degré (dans la graduation française en devenir). Chez les femmes aussi l'écart avec la vieille Europe est immense.
- Le Saussois libéré
Jean-Claude Droyer entreprend sa démonstration : les voies les plus significatives du Saussois, l'Arête Jaune (6b), la Der et le Jardin Suspendu (6c, dans la graduation française en devenir) sont réussies en escalade libre, équipement en place. La roche calcaire du Saussois ne se prête que pratiquement très mal à une protection à l'aide des coinceurs.
- Le Verdon libéré
Au Verdon, l'escalade libre fait son apparition au cours d'un rassemblement de grimpeurs de haut niveau. Les premiers itinéraires sont « libérés » : Necronomicon et le Triomphe d'Eros.
- L'escalade exclusivement
La publication de langue anglaise Crags est la première édition consacrée exclusivement à l'escalade sportive.
Année 1977 - La magnésie
La magnésie fait son apparition en Europe comme aide à l'escalade. Les drôles de petits sacs vont bientôt pulluler. Pourtant la magnésie était déjà utilisée, par quelques gymnastes-grimpeurs de la forêt de Fontainebleau, dans les années mil neuf cent cinquante. Notamment par un familier de Buthier-Malherbes, à la place de la résine pilée.
- Une nouvelle façon de faire
En modifiant sans précaution, ni concertation la position et le nombre des ancrages, Jean-Claude Droyer entreprend au Saussois de rééquiper pour l'escalade libre d'anciens itinéraires d'escalade artificielle, tels la Catastrophe qui devient le Penchant fatal et la Jules qui est appelée Valeurs misogynes ; la polémique gronde.
- Le septième degré au Saussois
Au Saussois, Jean-Claude Droyer réussit en escalade libre - ancrages en place - l'ascension de l'Échelle à poissons, la grande voie classique du massif. L'avancée dans la difficulté est réelle. C'est probablement la première fois que ce qui sera le septième degré (dans la graduation française en devenir) est constaté en bon style en France.
Son acharnement à vouloir supprimer tout point d'aide conduit Droyer à travailler les différents mouvements du passage clef, de façon à effectuer ensuite l'enchaînement proprement.
L'escalade libre après travail, ou escalade à la française, était inventée.
Persiflage sur cette façon de faire de l'autre côté du Chanel. Car les règles sportives de nos collègues britanniques sont très différentes, avec pose des ancrages pendant l'ascension et retour au pied de la longueur après un échec. Une méthode difficile à reproduire sur la nature compacte du calcaire des falaises de l'Yonne.
Année 1978 - L'échelle des difficultés
En 1935, Lucien Devies avait préconisé un double système de cotation des difficultés de l'escalade rocheuse, basé sur des comparaisons avec des ascensions de référence, séparant l'évaluation d'un passage d'escalade libre en six degrés, inspiré directement du système Welzenbach, proposé en 1924 dans les Alpes orientales, et l'estimation globale d'une ascension allant du « facile » à « l'extrêmement difficile » en six degrés également, en utilisant les chiffres romains.
Redisons que Lucien Devies, par des échanges épistolaires réguliers et rigoureux, chercha à stabiliser le système d'évaluations des difficultés de l'escalade, de 1935et jusqu'en 1978. Son influence comme corédacteur des principaux guides-itinéraires des montagnes de France à été déterminante pour stabiliser le système d'appréciation.
En 1966, l'Assemblée générale de l'« Union Internationale des Associations d'Alpinisme » (UIAA) avait proposé l'adoption générale du système Welzenbach de classification des difficultés en six degrés d'un passage d'escalade rocheuse, en décidant en plus et malheureusement, que le système avait une limite, le VI supérieur.
C'est-à-dire qu'il était fermé, alors que depuis longtemps, pour des escalades de blocs, existait un système qui, au-dessus du sixième degré, permettait de prendre en compte l'évolution de l'escalade.
En 1978, le guide-itinéraires Vallot utilise la graduation « Fontainebleau » pour qualifier des passages d'escalade dépassant le sixième degré supérieur, dans le massif du Mont Blanc, avec un indice alphabétique pour indiquer des degrés supplémentaires (VIb, VIc, VId, et jusqu'à VIh pour le bloc).
Évolution dans la classification des difficultés de l'escalade rocheuse, proposée par l'UIAA
La recherche du bon curseur, avec les propositions de 1924-1935-1966 pour codifier l'escalade, ne va pas connaître l'unification souhaitée. Avec la prise en compte de l'escalade sportive et de ses progrès fulgurants, la souhaitable uniformisation internationale se révélera impossible.
En 1978, l'Assemblée générale de l'UIAA décide d'ouvrir le système Welzenbach de classification des difficultés de l'escalade rocheuse de façon linéaire, après le VI vient le VII et ainsi de suite...
Mais le système se révélera inadapté, avec une progression excessive, et restera peu employé.
Chaque zone d'influence continuera de proposer sa graduation, en Europe occidentale, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Australie.
La classification des difficultés de l'escalade rocheuse, en France
En France, afin de prendre en compte les progrès de l'escalade libre, les grimpeurs imposeront, pour l'évaluation d'un passage d'escalade, une échelle différente plus exigeante, l'utilisation des chiffres arabes et trois échelons intermédiaires : a, b et c pour chaque degré.
Pour la haute difficulté, c'est-à-dire au-dessus du sixième degré, le système se trouvant encore trop inflationniste, on décide d'introduire une appréciation particulière entre les échelons intermédiaires. On rencontre donc le 7a limite supérieure, autrement dit 7a+, un langage d'abord réservé aux initiés et aux usagers.
Et peu à peu cette cotation deviendra d'un usage général en France et dans certains pays voisins.
Une seconde échelle apprécie l'ensemble d'une ascension allant du « facile » à « l'extrêmement difficile » en six degrés également, c'est l'estimation globale de l'itinéraire.
Avec les progrès sportifs constatés, apparaît un degré supérieur, proposé par nos amis suisses et se voulant humoristique « ABO » pour abominable.
Une grande confusion
Une grande confusion va perdurer, entre la graduation UIAA, employée principalement en Europe centrale, et celles utilisées en Europe occidentale, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Australie.
Lorsque certains indiquent un niveau VII (UIAA) d'un passage d'escalade, il n'est seulement question que d'un obstacle de difficulté 6b en France.
Plus tard, des graduations précisant les difficultés glaciaire et mixte viendront compléter l'information, et les chroniques alpines résumeront l'ensemble des difficultés dans un seul cartouche.
Équivalence des cotations
Ce n'est pas une « science » exacte, mais cela permet des discussions à n'en plus finir…
|
FR |
GB |
USA |
UIAA |
|
|
1 |
moderate |
5.2 |
I |
|
|
2 |
difficult |
5.3 |
II |
|
|
3 |
very difficult |
5.4 |
III |
|
|
4 |
4a |
5.5/5.6 |
IV |
|
|
5a |
4b/4c |
5.6/5.7 |
V- |
|
|
5b |
5a |
5.8 |
V/V+ |
|
|
5c |
|
5.9 |
VI |
|
|
6a |
5b |
5.10a |
|
|
|
6a+ |
|
5.10b/c |
|
|
|
6b |
|
5.10c/d |
VII |
|
|
6b+ |
5c |
5.10d/11a |
|
|
|
6c |
|
5.11a/b |
|
|
|
6c+ |
6a |
5.11b/c |
|
|
|
7a |
|
5.11c/d |
VIII |
|
|
7a+ |
|
5.11d/12a |
|
|
|
7b |
6b |
5.12b |
|
|
|
7b+ |
|
5.12c |
IX-/IX |
|
|
7c |
6c |
5.12d |
|
|
|
7c+ |
|
5.13a |
|
|
|
8a |
7a |
5.13b |
|
|
|
8a+ |
|
5.13c |
X |
|
|
8b |
|
5.13d |
|
|
|
8b+ |
|
5.14a |
|
|
|
8c |
7b |
5.14b |
|
|
|
8c+ |
|
5.14c |
XI+ |
|
|
9a |
|
5.14d |
|
|
|
|
|
|
|
|
Année 1978 - Le développement de l'escalade rocheuse
- Les ancrages scellés après un forage de la roche
En 1978, dans l'exploration des parois des Gorges du Verdon, une révolution va bouleverser les pratiques. Elle propose de tracer un itinéraire en fonction des possibilités de l'escalade, en ne restant plus tributaire du placement des moyens de protection, dans les fissures naturelles de la roche.
La ligne Dingomaniaque sera la première voie équipée avec des ancrages scellés, après le forage de la roche, et placés d'une façon réfléchie.
En Europe continentale, on assistera peu à peu à l'équipement systématique des falaises par des ancrages placés après forage.
- À ce moment là deux options
C'est à ce moment là, par une décision prise par les meilleurs grimpeurs du moment, que deux options vont s'écarter nettement :
- l'escalade rocheuse sécurisée, avec ancrages forés.
- l'escalade liée à l'alpinisme, avec des protections amovibles (coinceurs et pitons)
- Une dimension presque uniquement sportive
Auparavant, une forte dimension psychologique caractérisait l'escalade rocheuse, due aux incertitudes devant une éventuelle chute.
Avant 1914, il n'y avait aucune protection possible, le grimpeur progressait dans l'inconnue, et la chute du premier de cordée était inéluctable.
Avant 1945, avec les pitons, la corde en chanvre n'apportait aucune sécurité en cas de chute, souvent fatale, du premier de cordée.
Après 1945, la corde en polyamide permettait de parer la chute du grimpeur qui allait devant, mais une grande incertitude concernait la tenue des pitons, la chute restait exceptionnelle et aléatoire, et l'obstacle principal demeurait psychologique.
Après 1970, les coinceurs apporteront une nouvelle possibilité d'assurage et de pouvoir gérer son exposition, mais la chute volontairement déclenchée n'était pas une option conseillée.
Tout change en 1978, avec les ancrages scellés, après un forage de la roche, la chute devient une éventualité acceptable, quasiment banale, parfois volontairement déclenchée, l'escalade prend une dimension presque uniquement sportive, et des progrès gigantesques, dans la difficulté abordée, vont immédiatement suivre.
Les différents ancrages
En falaise pour les sites sécurisés, deux types d'ancrage scellé, après un forage de la roche, vont être régulièrement utilisés :
< Les « Spits », avec un diamètre qui évoluera de 8 mm au début pour atteindre 12 mm, soit une bonne sécurité, après la mise en garde d'Henry Sigayret, qui tentera en 1986 d'initier les équipeurs à la résistance des matériaux et aux règles du BTP.
< Les « Rings » forgés, qui assurent une certaine pérennité du scellement.
Il restera aux équipeurs à tenir compte de la corrosion, en particulier sur les falaises en bordure de mer…
- L'équipement par le haut
Antérieurement, il ne venait à l'esprit de personne d'équiper une falaise, de quelques hauteurs, par le haut.
Seule en 1965, la courte falaise de Surgy avait vu un équipement général des voies par Guy Richard, avec une implantation réfléchie des points d'ancrage placés en rappel. La technique du rappel encore archaïque, l'absence du baudrier et du descendeur limitaient les initiatives qui auraient provoqué un tollé…
Le credo était de partir du bas, de placer ses protections et ensuite d'élaguer… par suppression des points d'aide. La nouvelle génération proposera une façon radicale d'équiper des voies d'escalade avec les ancrages forés.
- L'escalade sécurisée
Désormais, on assiste à une implantation judicieuse des ancrages scellés, après le forage de la roche. Ce sera une façon de sécuriser l'escalade.
Ces escalades sont très souvent équipées depuis le haut en rappel.
Bien peu de sites d'escalade en France vont rester non équipés, pour permettre de grimper en plaçant soi-même ses protections.
Avec cette façon de faire, réalisée sans réflexion, sans concertation et sans précaution, les falaises de France, et d'autres pays voisins, seront bientôt couvertes de « Ring » et « Spits ».
Mais comme déjà remarqué, face à l'engouement, et sur une roche fragile comme le calcaire, les itinéraires, sans un équipement fixe, ne résisteraient pas à un délabrement dû aux placements et aux enlèvements successifs des coinceurs et des pitons.
Si cette façon de faire permet de multiplier à l'infini les possibilités d'escalade, c'est aussi un réducteur d'aventure... et la prolifération des ancrages scellés, après le forage de la roche, doit amener les grimpeurs à s'interroger sur l'état du terrain de jeu qui sera légué aux générations futures.
Dès lors, on va assister à l'équipement tous azimuts à l'aide des perforeuses électriques et à essence.
Des itinéraires sans équipement à demeure seront réservés à ce que certains appellent les terrains d'aventure, mais ils devront être choisis avec précaution pour éviter leurs dégradations rapides.
Cette nouvelle orientation - l'escalade sportive sécurisée - s'oppose radicalement aux règles des Britanniques, à celles du bord de l'Elbe et de certaines écoles américaines qui refusent et dénoncent cette méthode et cette assistance.
Un équipement qui atteindra les falaises d'altitude.
- Les éléments de sécurité
- Les coinceurs
Ils sont adoptés dès 1960 en Grande Bretagne, en 1969 en France.
Comme déjà souligné, après les articles de Patrick Cordier (LM&A n°2/1974) et d'Henri Agresti (LM&A n°2/1977), La Montagne & Alpinisme n°2/1978 revient sur l'aspect technique d'utilisation des coinceurs avec un article de Jean-Claude Droyer.
- Un coinceur automatique à cames
Une invention essentielle est proposée par le Nord-américain Ray Jardine, un coinceur automatique et réglable, reposant sur l'opposition de deux cames, - le Friend - qui sera plusieurs fois amélioré, pour arriver aux merveilles de technologie que nous utilisons aujourd'hui.
- Les dégaines
Au début de l'utilisation des pitons, certains se décordaient pour passer la corde dans l'anneau du piton, puis la connexion entre l'ancrage et la corde sera un mousqueton dès 1910, souvent avec un anneau de corde pour faciliter la circulation de la corde.
Jusqu'au milieu des années 1970, dans les voies nécessitant plusieurs pitons, les grimpeurs utilisaient des paires de mousquetons et des anneaux de corde pour rendre la liaison plus souple et le frottement moindre.
En 1978, apparaissent les « dégaines », un assemblage de deux mousquetons reliés par une sangle nouée, qui sera bientôt amélioré et proposé dans le commerce, avec une sangle cousue.
- Les cordes
Les améliorations dans la fabrication des cordes ont été constantes depuis 1950, dans la composition de la fibre synthétique, le perfectionnement du gainage, la diminution du poids et du diamètre. Le nombre de chutes acceptables pour une même corde a considérablement augmenté. L'amortissement de la chute - banale à la fin du siècle - accompagne l'élasticité du produit, le diamètre proposé ira de 12 mm en simple brin jusqu'à 8,2 mm, pour les cordes les plus techniques du moment.
- Les longueurs de corde entre les relais
Les longueurs de corde entre deux relais ont beaucoup augmenté, avec les progrès du matériel. L'amélioration de la technique, les dégaines, et surtout les ancrages forés qui limitent le frottement, par leur positionnement réfléchi, et la suppression des angles donnés à la corde, vont permettre des envolées grisantes.
De 15 m à 20 m dans les années mil neuf cent cinquante, les longueurs classiques possibles iront jusqu'à 40m à la fin du siècle.
Année 1979 - Le septième degré en Allemagne
Avec Bernard Arnold qui réussit Direkte superlative, le septième degré est atteint dans l'Elbsandstein, en Allemagne, avec l'éthique particulière à cette école : assurage sur ancrages, après le forage de la roche, tous les cinq mètres, plantés par le premier de cordée.
- La Super-Échelle
Au Saussois, Jérôme Jean-Charles réalise la Super-Échelle en escalade libre, ancrage un place. C'est une des grandes voies de référence du site qui se trouve ainsi « libérée ».
- Le septième degré dans les Calanques
C'est une ligne équipée et réussie par Didier Bitoun et Gérard Merlin - la triple directe - qui marque fin 1979 l'accès au septième degré dans les Calanques de Marseille, elle est cotée aujourd'hui 7a+.
- Le huitième degré
La première escalade au niveau du 8a est probablement l'exploit de Toni Yaniro, avec La Grande Illusion à Sugarloaf, aux États-Unis.
DANS LES ANNÉES 1980
Année 1980 - L'Ange en libre
Au Saussois, Laurent Jacob effectue l'escalade libre de l'Ange. (7 a+/7 b).
Le grand exercice d'escalade artificielle des années cinquante, et de tire-clous des années soixante-dix, devient le grand exercice d'escalade libre du massif. Ancrages en place évidemment, comme pour la plupart de ce qui se fait en Europe continentale.
- Le septième degré à Buoux
Jean-Claude Droyer enchaîne la Gougousse 7b, à Buoux.
- Chipanzodrome
Au Saussois, une ancienne ligne d'escalade artificielle la voie du Refuge est rééquipée en vue d'une escalade libre future. Petite voie de 12 m, étonnamment surplombante, c'est Chipanzodrome. Elle est la première "couenne" du Saussois, courte escalade très surplombante 7c+, inaugurée par Jean-Pierre Bouvier, en utilisant comme prises les trous formés par les pitonnages successifs antérieurs.
« Là où se trouvaient des pitons ou des cales de bois, l'œil neuf des protagonistes de l'escalade libre voit des prises et des verrous salvateurs » (J-B. Tribout).
- Pichenibule
Au Verdon, Patrick Berhault franchit, après travail et en bon style, le bombé de Pichenibule 7b+, c'est à cet instant la voie la plus difficile de France.
- Le look
Le petit monde de l'escalade entre sans précaution dans une période d'esthétisme du vêtement, du matériel et des accessoires : nouveau "look", nouvelle "frime", nouvelles "fringues", beau "matos". Ce qui paraîtra vite "ringard" un peu plus tard.
Année 1981 - La Haine
La marche en avant reprend, et c'est Patrick Berhault qui réussit la Haine, dans le massif de la Loubière, la difficulté est estimée 7c+.
- L'industrie de l'escalade
Premier rassemblement de grimpeurs de haut niveau à Konstein en Allemagne. Il est organisé par une firme commerciale, le signe d'un marché porteur..
C'est le début de l'industrie de l'escalade.
- Les chaussons résinés
En 1981, apparition sur le marché de chaussons d'escalade de fabrication espagnole, avec un caoutchouc très tendre et comportant en additif à la résine. Cette amélioration technique va permettre de nouvelles avancées.
- L'escalade, une discipline autonome
L'escalade sportive tend de plus en plus à constituer une discipline à part entière, souvent adoptée comme une fin en soi… Elle devient institutionnellement une spécialité reconnue, avec la création d'une Commission consacrée au sein de la Fédération Française de la Montagne.
Elle est, depuis longtemps déjà, une préparation physique aux courses de montagne ; mais aussi pour certains, une activité spécifique sans jamais de préoccupation pour les montagnes et l'alpinisme.
Un colloque est organisé en juin 1981, par le Groupe de Haute Montagne et la revue La Montagne & Alpinisme, pour accompagner un engouement certain.
Deux courants différents - proclamant se distinguer de l'alpinisme - apparaissent, même si tout n'est pas clairement exprimé.
Le premier regroupe le plus grand nombre d'adeptes, il s'intéresse à l'escalade en tant que sport autonome, mais la performance continue de dépendre du libre choix de l'objectif, par le grimpeur lui-même, suivant sa propre éthique, sa propre valeur esthétique, sa seule décision. Ces grimpeurs cherchent aussi à se démarquer des incertitudes, des dangers et des difficultés liés à la haute montagne, pour une discipline orientée vers le geste sportif.
Le second courant entraîne vers la compétition pure et dure ; il s'écarte délibérément des motivations habituellement invoquées par les grimpeurs de haut niveau. Le seul but devient le dépassement du voisin, avec règles précises et arbitres.
Là, le grimpeur n'est plus maître de son terrain de jeux, il s'agit de compétitions organisées par un élément extérieur, et de performances contrôlées par un environnement « officiel » et réglementé.
Remarquons qu'aucun des défenseurs du sport de compétition - avec arbitres, chronomètres et spectateurs - présents au colloque de Chamonix, n'invoque d'innocents jeux d'amateurs.
Ce qui conduit la démarche est essentiellement une échappatoire aux contraintes économiques, le grimpeur pouvant se consacrer entièrement à son sport, en louant son talent au sport-spectacle.
- La commission escalade de la FFM
Au sein de la Commission escalade fédérale, la compétition et la création d'un monitorat d'escalade sont mises en avant.
< La compétition était une orientation séduisante pour la FFM permettant d'affirmer un pouvoir, à l'image des autres structures sportives.
Mais vouloir réduire l'escalade à une simple activité consistant à se mesurer avec les autres pouvait interpeller.
< La création du diplôme de moniteur d'escalade rencontrait l'opposition frontale des Guides de haute montagne et la réserve - pour bien d'autres raisons - de la part des responsables associatifs de l'Enseignement alpin.
Évidemment il y avait des débats, car entraîner nos jeunes camarades, vers des objectifs professionnels incertains, pouvait provoquer et poser quelques scrupules... Mais avec la perspective de création d'emplois - objectif prioritaire des autorités de l'État du moment -, on était assuré de trouver de solides appuis.
Année 1982 - Une éthique claire
Plusieurs façons de faire sont maintenant clairement identifiées et acceptées par la majorité des grimpeurs :
- L'escalade libre intégrale
C'est la technique la plus exigeante des façons de grimper au niveau de l'éthique. Les points d'assurage sont à placer par le grimpeur durant sa progression ; et l'utilisation des moyens artificiels comme les pitons ne sont pas admis.
Les seuls points d'assurage acceptés sont les ancrages naturels et les coinceurs ; la paroi doit rester vierge de toute trace après le passage des grimpeurs.
C'est la meilleure façon de faire et le meilleur style possible, mais la pose de points d'assurage limite forcément beaucoup la recherche de la plus grande difficulté possible.
C'est souvent la seule technique acceptée sur certaines falaises des Îles Britanniques et dans certaines régions des USA.
Mais on arrive rapidement à des limites excessives d'engagements, lorsque la chute a des conséquences graves ou définitives.
- L'escalade libre à vue
Cette méthode permet une avancée plus grande dans la recherche de la difficulté ; les points d'assurage sont en place, et le grimpeur doit franchir le passage d'escalade sans travail, ni étude préparatoire.
La chute n'atteint normalement pas à l'intégrité physique du grimpeur.
S'il tombe, il doit repartir du bas de la longueur d'escalade, pour réussir éventuellement une escalade après tentative.
- L'escalade flash
Le grimpeur doit franchir le passage d'escalade sans travail préparatoire ; mais il a les informations de ce qu'il l'attend.
- L'escalade après travail
La voie peut être travaillée pas après pas, le grimpeur pouvant être assuré par le haut s'il le faut ; pour ensuite enchaîner l'escalade en bon style.
Cette méthode permet d'atteindre la plus haute difficulté possible.
Cette technique est régulièrement utilisée en France et en Europe continentale. C'est l'escalade libre après travail ou l'escalade à la française.
- La vie au bout des doigts
Pour les besoins d'un film : « La vie au bout des doigts », Patrick Edlinger réalise en solitaire quatre escalades notables à Buoux. C'est au niveau des médias le « scoop » absolu, qui va littéralement mordre dans l'opinion publique.
À partir de ce film, l'escalade devient une activité porteuse pour la publicité.
- Le 7 b et le 7 c à vue
Patrick Edlinger réalise à vue Captain Crochet 7b, à Buoux.
Puis encore à vue La polka des ringards 7c, toujours à Buoux.
Année 1983 - Le huitième degré
Dave Cuthbertson réussit Requiem à Dumbarton Rock en Écosse, c'est le premier 8a qui est proposé dans la grande ile, assurage sur coinceurs et escalade libre intégrale…
En France, c'est le début du très haut niveau technique et physique après travail.
Le consensus est général, l'avancée dans la difficulté est réelle pour trois escalades réussies durant la même année :
< Aux Eaux Claires, Crépinette, par Fabrice Guillot.
< À Buoux, Rêve de papillon, par Marc Le Ménestrel.
< À Buoux, Ça glisse au pays des merveilles, par Patrick Edlinger.
Ce sont les trois premiers « huit » de l'escalade en Europe continentale (8a).
Nous entrons dans le monde du huitième degré… Un privilège qui n'est encore réservé qu'à quelques-uns.
- Les nouveaux temples
En France, les nouveaux temples de la grimpe sont Buoux, Mouries et le Verdon.
On vient de partout en Europe pour la qualité de la roche, la beauté des escalades, le soleil... et l'équipement "béton" des falaises du sud de la France.
En Europe, de nombreuses falaises s'équipent, certains pays se révèlent particulièrement favorisés par leurs reliefs et leur soleil comme l'Espagne et l'Italie.
- Le mur d'escalade
Apparition des murs artificiels d'escalade en France, destinés d'abord à l'entraînement, et plus tard à la compétition.
- Les grimpeurs professionnels
L'entraînement systématique et quotidien et la musculation vont permettre de nouvelles avancées. Certains grimpeurs de haut niveau consacrent la majorité de leur temps à l'escalade et adoptent un statut professionnel, avec l'aide de l'industrie de l'escalade.
Année 1984 - Haut niveau féminin
Le premier 7c féminin est la performance de Lynn Hill, avec Vandals dans les falaises du massif des Shawangunks aux USA.
- Un nouveau progrès au Saussois
Au Saussois, la voie du Bidule est à son tour équipé pour l'escalade libre, encore une ligne courte et très surplombante où le grimpeur utilise les trous des anciens pitonnages, particulièrement gras et déversants.
Il y a encore une avancée dans la difficulté, la voie est classée 8a+. Ils sont trois à réussir l'enchaînement, les frères Le Ménestrel et Jean-Baptiste Tribout.
Les grimpeurs français ont rattrapé le décalage qui s'était constaté avec l'élite mondiale.
- Escalade à vue
Tournée « triomphale » de Jerry Moffat dans les lieux grimpables de France. Le grimpeur britannique réussit, en blocs et en falaises, les voies les plus dures de l'Hexagone.
Il est à ce moment-là, le meilleur grimpeur au niveau mondial.
Moffat réussit notamment au Saussois les lignes Bidule et Chimpanzodrome, en escalade à vue.
- Le premier 8b
Le premier 8b est probablement la voie Kanal Im Rücken, réussie par Wolfgang Güllich, dans l'Altmühtal en Allemagne.
- En solitaire
Au Saussois, la voie Chimpanzodrome est réussie en escalade solitaire par Marc Le Ménestrel, puis par Jean-Baptiste Tribout.
- Les chaussons modernes
Les chaussons d'escalade proposés aux grimpeurs ont subi de grandes améliorations techniques, avec le blocage du talon, les semelles adhérentes et la grande précision offerte. Avec ce nouvel équipement, le grimpeur gagne un degré entier dans l'échelle des difficultés.
- L'escalade sportive
Deux des plus actifs adeptes de l'escalade sportive David Chambre et Jean-Baptiste Tribout interviennent, dans la revue La Montagne & Alpinisme de 1985, pour faire le point sur l'évolution de cette discipline à Fontainebleau, en falaise, en montagne et à l'étranger.
Année 1985 - Buoux, haut lieu de l'escalade sportive
Dans l'évolution apparue en 1978, proposant de tracer un itinéraire en fonction des possibilités de l'escalade, et non plus en fonction des obligations de l'assurage, le site de Buoux va connaître un grand développement et acquérir une renommée internationale, mal anticipée par les ouvreurs, avec une fréquentation désordonnée et sans gêne ; irrespectueuse des autochtones et de l'environnement.
Devant l'émotion considérable provoquée dans le village, le maire décide d'interdire le site le 1er avril 1984. Les responsables de la FFM devront engager des discussions serrées avec les édiles et les propriétaires, l'intervention d'André Origny, président de la Section d'Avignon du Club Alpin et personnalité locale reconnue sera déterminante.
Au printemps 1985, l'escalade est de nouveau autorisée dans la partie est de la falaise, avec une série de recommandations contraignantes empêchant dorénavant le camping sauvage et le piétinement des truffières du plateau dominant la falaise de l'Aiguebrun.
- Un manuel pour l'équipement des falaises
Le COSIROC édite un petit opuscule technique destiné à l'équipement des falaises pour l'escalade sécurisée.
- Toujours plus
Sur le site de Mouriès, Catherine Destivelle réussit Fleur de Rocaille d'un niveau 7c+/ 8a… rejointe par Isabelle Patissier un peu plus tard…
- Le premier 8b+
Le premier 8b+ serait Punks In The Gym en Australie, gravi par Wolfgang Güllich.
- Le 8b en France
Les deux premières lignes, présentant une difficulté estimée en progrès par rapport à ce qui était gravi en France - c'est-à-dire 8b -, sont franchies par Marc Le Menestrel : Les mains sales, à Buoux et Fluide enchanté, à Mouriès.
Le sud de la France devient pour un moment le point de ralliement de tout ce qui grimpe dans l'exceptionnellement difficile.
- En solitaire
Escalade solitaire de la Haine, dans le massif de la Loubière par Alain Ghersen, la voie ne comptait que neuf ascensions protégées (7c+).
- En solitaire encore
En visite en Grande-Bretagne, Antoine Le Ménestrel réalise en solitaire, après travail, la seconde ascension de Révélation (8a).
Stupeur et surprise des Britanniques qui n'envisagent l'escalade solitaire que suivant leur éthique, c'est-à-dire à vue, sans travail préalable, protection à placer soit même.
- Équipement à la française
Alors que certaines écoles des U.S.A. et l'ensemble des sites britanniques maintiennent une éthique rigoureuse d'exclusion des points artificiels d'assurage, dans le Colorado on commence à équiper les falaises « à la française », c'est-à-dire suivant une implantation raisonnée des points de sécurité, permettant l'escalade la plus intéressante possible.
- Les premières compétitions
Les grandes manœuvres, pour l'instauration de compétitions d'escalade, se mettent en place, malgré la mise en garde des collègues britanniques du British Mountaineering Concil (BMC), la Fédération Britannique de la Montagne :
« Les informations selon lesquelles la Fédération française de la montagne aurait l'intention d'organiser une compétition nationale d'escalade en 1985 ont été accueillies avec consternation en Grande-Bretagne, à cause principalement des liens étroits noués depuis plusieurs années entre les grimpeurs français et britanniques ... En Grande-Bretagne actuellement les grimpeurs sont unanimement opposés à de telles compétitions et le B.M.C. est formellement opposé au développement des compétitions... »
Malgré les déclarations vertueuses des meilleurs escaladeurs français du moment, qui signeront « le Manifeste des 19 », mais qui ne résisteront pas longtemps à la tentation, les choses se précipitent.
Opportunité saisie immédiatement par la ville de Chamonix, son Club des sports et son Office du tourisme. Les organisateurs sont décidés à aller vite en matière de compétition, avec spectacle et show business et de prendre tout le monde de vitesse. Le Club des sports, aidé de ses principaux sponsors, mettra sur pied des « Internationaux de France d'escalade » du 20 au 23 juin 1985 ... On attend trois mille spectateurs et la télévision, sans laquelle on n'est rien….
Aussitôt tout le monde se précipite vers la félicité.
Une seconde compétition d'escalade a lieu en Italie à Bardonecchia, le 7 juillet 1985, avec performance de vitesse, difficulté et style.
Des compétitions sont proposées depuis 1947 en U.R.S.S., basées sur la vitesse, avec les concurrents assurés depuis le haut.
En France, les tenants des compétitions s'activent, il y a un pouvoir réel à acquérir, avec l'encadrement des compétitions, et la manne financière conséquente qui en découle, avec les licences et l'assurance obligatoire pour les compétiteurs, et aussi les retombées publicitaires escomptées. C'est sur ce modèle que fonctionnent les fédérations sportives…
Une éphémère Fédération Française de l'Escalade voit le jour.
Une compétition indoor est organisée à Vaulx-en-Velin en mars 1986, et à Troubat en extérieur, sur les falaises du site en septembre 1986.
Un nouvel événement est organisé sur les falaises de Biot en Haute Savoie en juin 1987. Mais les adaptations imposées pour les besoins de la manifestation et par les publicitaires vont montrer les limites du genre, prises taillées, arbres détruits, piétinement de zones sensibles ; et les trombes d'eau qui s'inviteront, n'arrangeront pas les choses…
Il apparaissait que ces manifestations - ouvertes au public - n'avaient pas leur place en falaise ; et que seuls des événements confidentiels pouvaient éventuellement y être envisagées. Les organisateurs de ces compétitions s'orienteront vers un environnement plus maîtrisable, les structures artificielles.
Année 1986 - Une lutte fraternelle
Après Marc, c'est le tour d'Antoine Le Ménestrel de s'illustrer, à Buoux avec la Rage de vivre, et en Suisse avec Ravage. Ces deux escalades proposent une nouvelle avancée, elle est prise en compte dans l'échelle des difficultés : 8b+.
- Le haut niveau féminin
Luisa Iovane inaugure en 1986, le premier huit féminin, avec Come back dans la Val San Nicolò en Italie.
L'année suivante, la ligne Rêve de papillon, 8a est franchie par Lynn Hill et Christine Gambert.
- Exportation française
Durant un voyage aux USA, Jean- Baptiste Tribout réalise à Smith Rock, dans l'Oregon, la voie To bolt or not to be en 8b+. C'est la première voie de cette difficulté réussie aux USA (5.14 suivant l'échelle américaine).
Longtemps en avance sur ceux de la vieille Europe, les grimpeurs américains marquent le pas. La voie ne pourra être reprise - à ce moment-là - que par Scott Franklin.
- Le dimensionnement des ancrages
Mise en garde d'Henry Sigayret, concernant l'utilisation d'ancrages, correctement dimensionnés, pour la protection des grimpeurs dans l'escalade rocheuse, (« Spit » de 12 mm et « Rings » forgés), dans la revue La Montagne & Alpinisme n°3/1986.
- Les moniteurs d'escalade
Création du brevet d'État escalade, au début il est lié à la filière de formation des Guide de haute montagne et à l'ENSA, avec option escalade. En 1989, une filière spécifique « escalade » viendra, clarifier les débats, malgré la forte opposition des Guides de haute montagne.
Année 1987 - En haut de la hiérarchie
Wolfgang Güllich réalise Wallstreet, au Frankenjura en Allemagne.
Il y a un degré de difficulté supplémentaire de franchi, par rapport à tout ce qui a été fait précédemment ; nous sommes dans le 8c…
- Au même moment
La même année, Jean-Baptiste Tribout en franchissant, dans les gorges du Verdon, la ligne qu'il appellera Les Spécialistes, se hisse également en haut de la hiérarchie en 8c.
Cette performance exceptionnelle sera d'abord répétée par Patrick Edlinger.
- Le 8a à vue
Antoine Le Menestrel réalise à vue Samizdat 8a, au Cimaï.
- La Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade
La « Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade » naît le 13 septembre 1987, à la suite au retrait de l'éphémère Fédération de l'Escalade...
Ce changement d'objet montre que la montagne n'est plus la seule préoccupation de la FFME, et que comme les autres structures fédérales, elle va être détentrice du pouvoir qui manquait à la FFM, l'organisation des compétitions d'escalade génératrice de licences et d'adhésions.
Année 1988 - Haut niveau féminin
Les quatre voies classées 8a sont reprises par Catherine Destivelle : Rêve de papillon, Élixir de violence, la Diagonale du fou, à Buoux et Samizdat, au Cimaï. Elle réussit également Choucas 8 a+, à Buoux.
Isabelle Patissier escalade Sortilèges en 8b, au Cimaï. Une ligne qui est reprise par Lynn Hill et Christine Gambert l'année suivante.
- Un engouement certain pour l'escalade
L'engouement pour l'escalade - accompagné par une presse spécialisée uniquement centrée sur cette discipline - devient très sensible au sein des clubs, au détriment des valeurs beaucoup plus contraignantes de l'alpinisme. Malgré les efforts des associations pour démocratiser la discipline, l'alpinisme restera une activité élitiste « sans justification valable ».
L'escalade propose une pratique sportive beaucoup plus accessible et plus simplifiée, nécessitant moins d'engagement.
- L'escalade à travers les âges.
La revue La Montagne & Alpinisme propose un essai de chronologie sur l'escalade à travers les âges (LM&A n°2/1988).
Année 1989 - Le niveau 8c
Marc Le Menestrel atteint le niveau 8c dans Azincourt, à Buoux.
DANS LES ANNÉES 1990
À ce moment-là, il y a déjà plus de cent escalades, cotées 8a, réussies en escalade libre et les grimpeurs français sont très présents dans le haut de la hiérarchie...
Mais rapidement, de nouveaux concurrents se présentent et vont encore faire bondir le compteur.
Année 1990 - La progression continue
Le premier 8c+ est probablement Hubble, à Peak District, par Ben Moon.
Le premier 8b+ féminin est gravi par Lynn Hill, avec Masse critique, au Cimaï.
- Les moniteurs d'escalade
En 1990, la limite de compétence des moniteurs d'escalade, diplômés depuis 1986, passe de 800 à 1500m, pour les falaises d'altitude.
Afin de calmer les oppositions et la grogne des Guides de haute montagne, les sites accessibles ne doivent pas être défendus par des zones de neige ou de glace, réclamant l'usage des équipements appropriés.
Année 1991 - Action Directe
Le neuvième degré est un lieu délicieux qui fait beaucoup écrire et beaucoup parler, mais qui va rester un moment très peu fréquenté…
En 1991, Wolfgang Güllich réalise une voie mythique, Action Directe dans le Frankenjura en Allemagne, qui est un jalon majeur de l'historique de l'escalade.
C'est, après palabres, le premier 9a réalisé et certainement la référence la plus connue.
Année 1993 - Le 9a en France
Fred Rouhling inaugure Hugh, aux Eaux-Claires. C'est le premier 9a en France.
Année 1995 - Le 9b en France ?
Fred Rouhling annonce Akira en Charente et revendique le premier 9b. La voie n'a jamais été reprise et suscite les interrogations jamais levées de ses collègues.
- Dans ces années-là, dans les Calanques
Dans ces années-là, dans les Calanques, la grotte de l'Ours concentre les voies les plus difficiles du site avec UFO 8c ; Massey Ferguson 8b+ (qui sera réalisée à vue par Elie Chevieux) ; Rastata 8b ; Rio de janvier 8b ; le Bilboqueur 8b+ ; Sacchi Shonedelba 8b. Des voies équipées par Fred Rouhling, Jean Luc Jeunet, Olivier Fourbet et Jérôme Rochelle.
Année 1996 - Le 9a+ confirmé
Alexander Huber marque un échelon supplémentaire avec 9a+, en réalisant la première ascension d'Open Air. Un cran confirmé par le répétiteur Adam Ondra.
À ce moment-là, certains ouvreurs protesteront devant l'inflation dans la haute difficulté. On se doute bien que le consensus est difficile à trouver, entravé par certains egos.
Ce sont les falaises d'Espagne et du Frankenjura qui offrent le plus de possibilités pour des itinéraires de haut niveau.
Année 1998 - Haut niveau féminin
Josune Bereziartu va élever le haut niveau féminin avec Honky Tonky en 8c, à Araotz en Espagne.
Elle va ensuite réaliser une série époustouflante de performances de ce niveau et plus.
DANS LES ANNÉES 2000
Année 2000 - Haut niveau féminin
Josune Bereziartu accède au 8c+ en 2000, avec Mélange Honky, à Araotz en Espagne.
D'autres grimpeuses apparaîtront dans le 8c/8c+, dès 2000 avec Marietta Uhden, Liv Sansoz, Jenny Lavarda, Angela Eiter, Charlotte Durif, Daila Ojeda, Nina Caprez, Caroline Ciavaldini et Sasha Di Giulian.
- Le 9a dans les Calanques
Les Calanques de Marseille ont leur voie difficile, avec le 9a de Roby in the sky, réalisée par François Legrand et confirmée par Adam Ondra.
C'est dans la grotte de l'Ermite, une extension de "La Baume" déjà proposée en 8b, pour accéder à la terre promise… à seulement quelques élus.
Année 2001 - Le 9a+ à Céüse
La voie Realization, 9a+ est gravie par Chris Sharma.
Année 2002 - Haut niveau féminin
Josune Bereziartu franchit le 9a de Bain de sang, à Saint-Loup en Suisse.
Elle est rejointe en 2011 par Beth Rodden, Natalija Gros, Maja Vidmar, Charlotte Durif, Sasha DiGiulian, Alizée Dufraisse, Johanna Ernst et Jenny Lavarda.
Année 2003 - Le premier 9b confirmé
C'est le premier 9b confirmé. La ligne Chilam Balam est proposée par Bernabé Fernandez, mais sa réalisation reste controversée, elle est répétée par Adam Ondra en 2011 et sa cotation confirmée.
Année 2005 - Haut niveau féminin
Josune Bereziartu franchit le 9a/9a+ de Bimbaluna à Saint-Loup en Suisse. Le haut niveau féminin talonne vraiment le haut niveau masculin.
Année 2007 - Le 9a+ dans le Faucigny
Fred Rouhling inaugure Salamandre 9a+ en 2007, et Empreintes 9a+ en 2009 ; dans les falaises du Faucigny en Haute-Savoie.
DANS LES ANNÉES 2010
Année 2010 - Le 9a+ sur Sainte-Victoire
Gérôme Pouvreau inaugure la voie Aubade directe sur une falaise du socle de la montagne Sainte-Victoire.
La ligne est répétée et confirmée par Enzo Oddo avec 9a+.
- Le 9a+ à Céüse
La même année, Adam Ondra escalade L'étrange ivresse des lenteurs à Céüse, encore 9a+.
Un autocontrôle justifié, un curseur nécessaire
Notons que, depuis quelque temps, avec les niveaux vertigineux atteints, et en l'absence d'un curseur indiscutable, les progrès annoncés demandent la confirmation des collègues... de ce niveau… et en la présence de l'un d'eux.
Pour éviter les fantasmes et autres chimères.
Année 2011 - Encore dans le 9a+
< C'est La Moustache qui fâche, à Entraygues, par Enzo Oddo.
< C'est La Madone à Lourmarin, par Gérôme Pouvreau.
- Dans le 9b
De 2003 à 2013, douze voies sont inaugurées principalement en Espagne par Daniel Andrada, Adam Ondra et Chris Sharma.
- Dans le 9b+
Depuis 2012, Adam Ondra réalise 3 voies de ce niveau, d'abord Change, en Norvège en 2012, la Dura Dura en 2013 confirmé par Chris Sharma et Vasil Vasil en République Tchèque.
Année 2020 - Des grimpeuses de très haut niveau !
- Julia Chanourdie réalise le premier 9a+ par une grimpeuse française, à Saint-Léger-du-Ventoux.
- Nolwen Berthier et Oriane Bertone obtiennent leur premier 8c+ à Saint-Léger.
- Mélissa Le Névé est la première à escalader la mythique ligne Action directe, une performance tout à fait exceptionnelle.
- L'Italienne Laura Rogora escalade la combinaison en 9a+ d'Underground à Massone.
- Le duo américain Margo Hayes et Paige Classen réalise Kryptonique, le premier 9a chez l'oncle Sam.
Nous sommes là en haut de la hiérarchie… du moment.
Année 2021 - L'escalade, sport olympique
Suite à une décision de 2016, l'escalade devient un sport olympique. Prévu en 2020 et retardé en 2021, à cause de la pandémie covid, les Jeux olympiques de Tokyo ont offert un aperçu inespéré, à la discipline.
Les Jeux de Paris de 2024 viendront confirmer l'escalade, comme sport olympique.
Année 2022 - La garde des falaises favorables à l'escalade
Jusque-là, la FFME signait des conventions « d'autorisation d'usage avec les propriétaires privés et publics de terrains favorables à l'escalade », dont l'effet était de transférer la garde de la falaise à l'organisme fédéral.
La fréquentation importante de l'escalade en falaise, avec les accidents qui en résulteront et devant plusieurs décisions de justice, amèneront la FFME à dénoncer les accords conclus jusqu'alors.
Devant cette situation inquiétante, les autorités de l'État ont apporté les corrections nécessaires.
La FFME indique :
C'est une étape majeure dans l'objectif d'un partage plus juste des responsabilités dans la gestion des sites naturels d'escalade français :
Le gardien d'un site n'est plus responsable en cas de dommage résultant « de la réalisation d'un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée ».
La loi N° 2022-217 du 21 février 2022 est parue au journal officiel.
Ce texte prévoit que le gardien de l'espace naturel dans lequel s'exerce un sport de nature n'est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d'un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée.
La FFME précise :
Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire pour la fédération : sortir définitivement et rapidement de l'ancien modèle des conventions d'autorisation d'usage au profit d'un nouveau mode de gestion équilibré avec les collectivités territoriales. Définir et préciser collégialement ce que recouvrent les risques normaux, prévisibles, inhérents à nos activités. Tels que décrit dans ce nouveau texte de loi, travailler efficacement sur l'information des usagers des sites et, enfin, poser la question du financement des équipements nécessaires à l'aménagement des sites. Tout cela, bien sûr, en collaboration avec tous les acteurs et les utilisateurs des espaces.
Depuis le 23 février 2022, tous les accidents d'escalade en extérieur sont donc soumis à ce régime qui reconnaît l'escalade comme une activité sportive intrinsèquement risquée : en pratiquant l'escalade, le grimpeur doit désormais accepter le risque qui en découle.
Des conventions sont en cours de négociation dans de nombreux sites.
LES SUITES DE LA CHRONOLOGIE DE CE DOSSIER DEVRONT ÊTRE AJOUTÉES ULTÉRIEUREMENT

2 - ÉCOLE DE BLOCS
ÉCOLE DE BLEAU
Pour bien saisir l'évolution de l'escalade, il faut regarder ce qui se passe dans le véritable laboratoire du geste, qu'est l'escalade de blocs.
Avec ses faibles hauteurs à gravir, ses mouvements intenses, mais peu soutenus et ses chutes, qui peuvent être sans conséquence - mais pas toutes -, l'escalade de blocs est une référence absolue de la difficulté, elle laisse aussi, dans le temps, l'empreinte des générations successives.
C'est probablement avant 1900, sur le site de Lake District en Angleterre, que les premières approches de l'escalade de blocs sont observées.
Dès 1908 ou 1906, un terrain de jeu aux ressources presque inépuisables est découvert dans la forêt de Fontainebleau, fréquentée par les caravanes d'excursionnistes du Club Alpin dès 1874.
Comme déjà signalé, nous nous limiterons (pour le moment) aux rochers de Fontainebleau qui proposent, en raccourci, ce qui se fait dans le monde particulier du bloc…
La forêt de Fontainebleau
Les sentiers dans les beaux chaos gréseux sont proposés depuis 1832 par le sylvain Claude François Denecourt (1788-1875), avec le balisage par des marques de peinture sur plus de cent kilomètres de sentiers.
Précurseur, il publie aussi un « guide du voyageur et de l'artiste à Fontainebleau » dès 1839, qui permettra le financement de son action et sa promotion.
L'arrivée du Chemin de fer, en 1849, rendra la forêt accessible depuis Paris, ce qui participera grandement à la popularité de la forêt.
L'œuvre sera poursuivie par Charles Prosper Colinet, (1839-1905), il consacrera quarante ans de sa vie et jusqu'en 1905 à la belle forêt, avec le concours du Club Alpin.
Les grès de la forêt de Fontainebleau sont visités régulièrement par les caravanes du Club Alpin dès 1874, et notamment par les Caravanes scolaires, il est donc possible de situer avant 1906-1908 un début d'intérêt pour l'escalade des blocs de la forêt.
Probablement à peu d'endroits dans le monde, nous ne trouverons une aussi grande possibilité d'escalades, une aussi grande variété de mouvements techniques et physiques, que sur les blocs de grès de la forêt de Fontainebleau. Et dans le temps une aussi vaste somme de performances…
Depuis le début du XXe siècle, en France, en ce qui concerne l'escalade de blocs, c'est là que beaucoup d'événements se sont produits, et c'est là que beaucoup de performances ont pu être enregistrées…
Ensuite, dans les années mil neuf cent quatre-vingts, partout en Europe et dans le monde, ce type d'escalade se développera considérablement.
Aujourd'hui, d'autres sites ont acquis une renommée équivalente, sinon plus prestigieuse, mais « l'école de Bleau » reste une référence…
Une échelle des difficultés appliquée à cette discipline s'est peu à peu organisée, sans lien avec l'escalade en falaise, au début également en six degrés, puis le système s'ouvrira vers le haut pour arriver aujourd'hui à neuf degrés et bientôt plus. Pour ne pas ajouter à la confusion entre bloc et falaise, nous marquerons les degrés avec des lettres majuscules (par exemple 6A, 7B…).
Un essai de chronologie
Année 1874 et ensuite
Les grès de la forêt de Fontainebleau sont visités régulièrement par les caravanes d'excursionnistes et par les caravanes scolaires du Club Alpin.
DANS LES ANNÉES 1900
Année 1908 - Le début de l'escalade à Fontainebleau et le groupe des Rochassiers
Dès 1908, peut-être 1906, issu des anciens des Caravanes scolaires de la Section de Paris du Club Alpin, un petit groupe informel de grimpeurs commence à fréquenter régulièrement les massifs de rochers de la forêt de Fontainebleau, dans le but de s'initier et de s'entraîner à l'escalade : « Le Groupe des Rochassiers » comprenant entre autres Jacques Wehrlin, Pierre Lebec et André Jacquemart (voir les dossiers du CFD : Un historique du Club Alpin Français et le Groupe de Haute Montagne).
Un article de Jacques Wehrlin « À l'entraînement » évoque pour la première fois l'escalade de blocs en forêt de Fontainebleau dans la revue La Montagne de 1914. C'était d'abord un but de préparation pour la montagne, car « l'hiver les muscles s'engourdissent, la résistance diminue, les mouvements perdent leur précision »...
- Le bloc Wehrlin
Escalade en chaussures à clous de la fissure historique du Cuvier-Châtillon, par Jacques Wehrlin, l'animateur du Groupe des Rochassiers.
Le rocher mitoyen prendra - un moment - le nom de ce précurseur - le bloc Wehrlin - comme en attestent les guides-itinéraires de Maurice Martin consacrés à l'escalade de blocs en forêt de Fontainebleau, publiés de 1944 à 1956.
Un témoignage « bleausard » de celui tombé, mortellement blessé, durant la Grande Guerre en 1916 « en franchissant un formidable barrage devant lequel le courage de beaucoup avait faibli ».
Plus tard, l'usage (qui a mauvaise mémoire) en décidera autrement, et étant donné que, comme en matière de toponymie, « il y a des courants que l'on ne remonte pas », le monolithe deviendra le bloc du Carré d'As.
DANS LES ANNÉES 1910
Année 1913 - Les espadrilles d'escalade
Apparition des espadrilles à semelle de corde, introduites pour l'escalade des rochers de Fontainebleau, par Jacques de Lépiney.
Le troisième degré supérieur
Escalade de l'arête de Larchant du bloc la Dame-Joanne, sans corde, par Jacques de Lépiney, en espadrille à semelle de corde. Le passage est aujourd'hui classé troisième degré, limite supérieure, dans l'échelle des difficultés appliquée à cette discipline.
L'orthographe du bloc Dame Jouanne est incertaine. (Joanne, Johanne), mais l'IGN a retenu Jouanne.
Année 1914 - La fissure de la Prestat
En grimpant en espadrilles à semelle de corde, Jacques de Lépiney réussit l'escalade de « la fissure de la Prestat » au Cuvier-Chatillon. C'est le plus célèbre mouvement d'escalade, sur le bloc le plus fameux de la forêt de Fontainebleau. Le quatrième degré de difficulté est atteint.
Aujourd'hui, un feuillet de roche a été cassé et le passage est un peu plus commode.
Année 1919 - Le GHM
Issu du Groupe des Rochassiers, c'est la création du Groupe de Haute Montagne, et la naissance d'un alpinisme français sportif et élitiste...
DANS LES ANNÉES 1920
Année 1924 - Les lieux grimpables et le GDB
Les lieux grimpables à la mode sont le Cuvier-Chatillon et la Dame Joanne. Création du Groupe de Bleau (GDB), avec notamment Bobi Arsandeaux et Guy Labour.
Année 1929 - La Paillon
Hugues Paillon effectue la première escalade du versant est du bloc de la Prestat, par la voie diagonale ; la difficulté atteint le quatrième degré limite supérieure.
DANS LES ANNÉES 1930
- La Fissure des Alpinistes
Un bloc exceptionnel, un peu à l'écart dans l'Envers du massif d'Apremont, « la fissure des Alpinistes » est d'abord réussie par Hugues Paillon, au début des années trente, en 1932 ou 1933 (lettre de Mme Paillon du 26 juin 1988, elle-même pratiquante active). Elle ne sera reprise que plus tard, probablement en 1934, par Pierre Allain (lettre de Pierre Allain du 2 juillet 1988).
- La Paillon directe
Hugues Paillon escalade la fameuse voie directe du versant est du bloc de la Prestat ; un standard du cinquième degré (date incertaine mais bien antérieur à 1938, lettre de Mme Paillon de 1988) ; la prise intermédiaire et celle de sortie ont été améliorées et sculptées ultérieurement (lettre de Mme Paillon), probablement par Authenac.
Année 1933 - L'école d'escalade
Création de la première école d'escalade organisée par Hugues Paillon, et la Section de Paris du Club Alpin. Des moniteurs du Club proposent des séances d'initiation et de perfectionnement à l'escalade. Dès 1926 et jusqu'à la Seconde guerre mondiale Hugues Paillon sera l'auteur des principales escalades difficiles des blocs de la forêt, suivi plus tard par Pierre Allain et ses amis.
- La Traversée du Cuvier
Un parcours non jalonné, très fréquenté par les grimpeurs de haut niveau, conduisant de bloc en bloc et reprenant le répertoire des escalades les plus intéressantes et les plus difficiles, constitue « La Traversée du Cuvier ». Beaucoup plus tard, les grimpeurs diront « le Porte à Porte »… Il n'y a pas de continuité, comme pour plus tard les circuits fléchés d'escalade.
Année 1935 - Les espadrilles
On grimpe en espadrilles, avec semelle de crêpe ou de caoutchouc, les Gouik.
Pierre Allain essaie les premiers prototypes de ses futurs chaussons PA.
- Le premier six
Pierre Allain franchit « l'Angle Allain » au Rempart du Cuvier. C'est le premier passage d'escalade de bloc classé sixième degré dans l'échelle des difficultés appliquée à cette discipline. Le passage est aujourd'hui un peu dévalué...
- La résine
Début d'utilisation de la résine pilée, comme aide à l'escalade, c'est le célèbre « Pof », un petit sac de résine pilée au bruit caractéristique, lorsqu'il est utilisé pour nettoyer ou sécher le grès.
- Un premier inventaire
Un premier inventaire des escalades à Fontainebleau est publié en 1935 dans le livre de Jean Loiseau : « Le massif de Fontainebleau », Édition Les Compagnons-Voyageurs.
Année 1936 - La Borniol
La Borniol est l'un des beaux gestes du Cuvier-Châtillon dans son registre de difficultés, il est réussi par Daurat, dit Borniol ; difficulté cinquième degré.
Année 1938 - Une gymnastique
Ouverture d'un gymnase à Paris, par le docteur Pierre Madeuf, conçu pour l'entraînement à l'escalade.
DANS LES ANNÉES 1940
Année 1942 - Les prises sculptées
Charles Authenac sculpte, au Bas Cuvier, un certain nombre de prises permettant les grandes voies classiques d'aujourd'hui du cinquième degré, tels le Quartier d'Orange, la Route nationale, la Paillon directe et autre Angle Authenac.
- La vallée de Cham
Création de la clandestine série de bivouacs, près du Cuvier, au lieu-dit « la Vallée de Cham », site réservé aux Bleausards et... « interdit aux Mathieux, Scouts et autres Ajistes ».
Année 1944 - Les forçats du Bas Cuvier
Le groupe très actif de grimpeurs, fréquentant le Bas Cuvier, applique pour l'escalade de blocs un entraînement systématique ; cela ne concerne évidemment que le seul jour de repos hebdomadaire, le dimanche…
Sous les sarcasmes de la publication Le Bleausard : « Les forçats du Cuvier peuvent être vus en pleine action, mais seulement dans un rayon de cent mètres du mirador de la Prestat, le bagne ayant ses limites à peu près à cette distance ».
Le Bas Cuvier devient le véritable laboratoire du geste ; c'est là que l'escalade des blocs est travaillée à son plus haut niveau. C'est le « centre du monde » pour l'escalade de blocs ! ...au dire des plus mordus...
- Les topos de Bleau
De 1944 à 1955, en procédant initialement au relevé général des blocs intéressant l'escalade en forêt de Fontainebleau, Maurice Martin et Jean Bourgoin publient sous la patronage du Club Alpin, une série de fascicules très bien informés et peu à peu remaniés, consacrés à l'escalade des blocs de la forêt, premier éditeur Gérard Chacun, puis directement le Club Alpin.
Ils concernent les massifs du Cuvier-Chatillon, du Rempart du Cuvier, du Puiselet, de la Dame Joanne, de l'Éléphant, de Chamarande et du Pendu ; pour chaque bloc sont précisés le nom du mouvement et l'estimation de la difficulté. C'est, bien sûr, une cotation particulière à cette escalade qui est adoptée en six degrés, dérivée de l'échelle Welzenbach, mais beaucoup plus sévère d'un et demi à deux degrés (voir le dossier du CFD : Les guides-itinéraires pour l'escalade).
Année 1945 - Le CAC
Création du Cuvier Academic Club, avec comme chef de file Pierre Allain. C'est un petit groupe de grimpeurs de haut niveau, extrêmement dynamique, familier du Bas Cuvier, comprenant entre autres Pierre Allain, René Ferlet, Guy Poulet, etc., avec les surnoms bleausards : le Vieux, le Prince, le Gros, etc.
L'esprit bleausard, l'entraînement et l'émulation sont très poussés. Aux six degrés de la difficulté de l'escalade, les bleausards du CAC ajoutent une classification du talent des grimpeurs allant du « lamentable débris » du premier degré en passant par « l'honorable grimpeur » jusqu'aux « trés pures lumières » du sixième degré. En passant par « le tendre espoir popoffiste » pour le troisième degré, « l'honorable grimpeur et le puissant seigneur du gratton » pour les quatrièmes et cinquièmes degrés.
Le « mathieu » étant le degré zéro, on l'aura bien évidemment deviné.
Année 1946 - La Marie-Rose
René Ferlet réussit le plus beau et le plus célèbre mouvement d'escalade difficile du Bas Cuvier « la Marie-Rose », sur le bloc aux deux arêtes. Une référence cotée encore aujourd'hui 6A, avec le caoutchouc à gomme adhérente des chaussons d'escalade d'aujourd'hui...
- Au-delà du sixième degré
René Ferlet écrit au sujet des cotations des difficultés en escalade :
« Tout ce qui se ferait de plus difficile que le VI formerait le septième degré et peut-être le huitième ».
Année 1947 - Le premier circuit
Réaliser un enchaînement de mouvements pour permettre une continuité dans l'effort et une variété dans l'escalade, voilà l'objectif du premier circuit fléché qui amène d'un bloc à un autre, en évitant le retour au sol. Le niveau technique des mouvements d'escalade permet un parcours par le plus grand nombre.
Il est tracé au Rempart du Cuvier par Wilfred (Fred) Bernick. La difficulté varie du second au troisième degré...
Année 1948 - Les chaussons d'escalade PA
En 1948, et après une longue mise au point commencée en 1935, Pierre Allain introduit sur le marché, dans son célèbre magasin de la rue St Sulpice à Paris, un chausson d'escalade à semelle caoutchouc de marque PA.
Le fameux chausson bleu sera immédiatement l'outil indispensable pour l'escalade à Fontainebleau.
Curieusement, ils resteront en France réservés, à quelques exceptions près, aux blocs de Fontainebleau encore vingt ans.
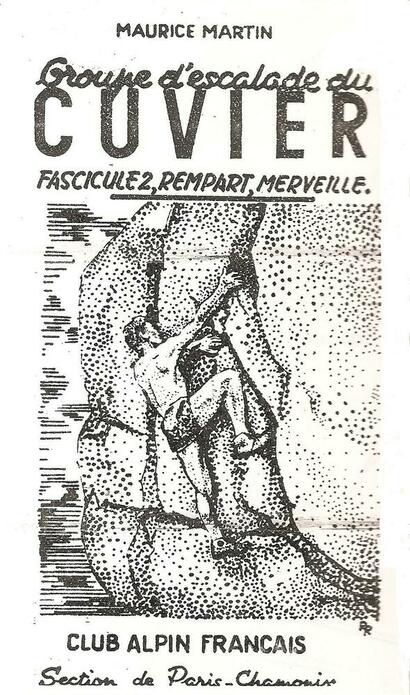
DANS LES ANNÉES 1950
Année 1950 - La Stalingrad et le Carré d'As
Paul Jouy réalise deux mouvements parmi les plus fameux du Bas Cuvier, la « Stalingrad » en 6B sur le bloc de la Prestat, et le « Carré d'As » en 6C sur le bloc Wehrlin, devenu aujourd'hui le bloc du Carré d'As…
Année 1952 - La Quatrième arête
Michel Dufranc inaugure la "Quatrième arête", sur le bloc aux deux arêtes... qui en compte évidemment quatre... C'est un mouvement bleausard dans toute sa splendeur, qui attendra au moins quatre ans avant d'être repris avec 6C.
- Bois Rond devient terrain militaire
L'Armée rachète le domaine de Bois Rond qui servira de terrain de manœuvres… ce qui évita l'appropriation par le privé de cet espace unique...
Année 1953 - La Joker
Robert Paragot est le premier à réussir l'exceptionnel mouvement de la « Joker », sur le bloc aux deux arêtes. Une « première » très convoitée, le même jour Michel Dufranc l'accompagne dans la performance, qui est aujourd'hui encore cotée 7A pour la difficulté.
Ce mouvement permet de juger du niveau atteint à l'époque...
Année 1956 - Les guides des escalades des blocs
Maurice Martin actualise les guides des escalades des blocs du Bas Cuvier, du Rempart et de certains autres comme celui du Puiselet. Pour le Bas Cuvier, la difficulté sortant de l'échelle classique des six degrés, on indique chaque progrès par un indice alphabétique VIa, puis VIb, etc… En 1953, avec la Joker, on en est au VIf pour la difficulté, et plus tard certains mouvements atteindront le VIh et plus (voir le dossier du CFD : Les guides-itinéraires pour l'escalade).
Ce n'est que plus tard en 1978 qu'une progression linéaire sera adoptée, après 6 ce sera 7 puis 8.... À chaque degré, il y a trois paliers intermédiaires A, B et C. Les avancées supplémentaires sont marquées par un plus (7A+ par exemple). Tout ceci pour éviter l'inflation.
- Un monde de bleausards
Chaque fin de semaine, par le train, le car ou en auto-stop et plus tard en voiture, un petit monde de bleausards rejoint la belle forêt de Fontainebleau, avec nourriture, eau (et vin), afin de vivre hors du temps, pour retrouver les blocs d'escalade et la randonnée, avec soirée et nuit dans les bivouacs plus ou moins bien aménagés, creusés sous les plateaux ou sous les blocs gréseux. Des réveils en forêt le matin, avec la proximité de quelques cervidés sereins, restent des souvenirs ineffaçables.
Cette tradition commencée dans les années d'avant-guerre, sera plus tard étendue au week-end. Souvent, pour certains, du vendredi soir au lundi matin.
Cette vie en marge perdurera jusqu'aux années mil neuf cent soixante dix.
Année 1956 - La fraise écrasée
Le premier circuit difficile d'escalade est fléché dans le massif d'Apremont, par les frères Sennelier, niveau cinquièmes degré, la couleur du fléchage du circuit est celui de la fraise écrasée. La difficulté d'ensemble du circuit est qualifiée de très difficile limite inférieure (TD inf.). Déjà le retour au sol, évité pour les premiers circuits, n'est plus respecté pour préférer la continuité dans la difficulté.
DANS LES ANNÉES 1960
Année 1960 - L'Abattoir
Autre passage historique « l'Abattoir » place Morin du Bas Cuvier, avec un mouvement technique en avance sur son temps. Il est réussi par Michel Libert, le meilleur grimpeur de blocs de ces années-là. Il est estimé aujourd'hui 7A+.
- Le Blanc du Bas Cuvier
Succédant à la « Traversée du Bas Cuvier », prend forme sous une discrète numérotation blanche, dans un enchaînement suffisamment stable et achevé, le circuit blanc du Bas Cuvier.
C'est un circuit que les initiés appellent « le porte à porte » où l'on va de bloc en bloc, sans intention de continuité, pour tenter les passages les plus notables du site. C'est le livre ouvert de l'histoire de l'escalade extrême, et le répertoire du savoir-faire bleausard. Le premier bloc c'est la « Lili », après il faut suivre, on peut arriver à les gravir tous, puis il faudra essayer de durer... et chaque génération ajoute son savoir-faire.
Dans ces années-là, Michel Libert et Roland Trivellini marquent l'époque par leur talent. La difficulté d'ensemble du circuit est qualifiée d'extrêmement difficile limite supérieure (ED sup.)
Année 1961 - L'autoroute du sud coupe la forêt en deux
Suite au manque certain de vigilance des associations et à l'invraisemblable irresponsabilité de l'administration, la forêt de Fontainebleau sera coupée en deux par l'autoroute du sud.
Un gâchis irréparable…
Les positions prises par nos instances, en faveur d'un tracé de l'autoroute évitant la forêt de Fontainebleau par l'ouest, ne seront pas suffisamment appuyées et ni défendues.
Et le réveil tardif d'autres groupements et quelques gestes irresponsables n'y feront rien…
Plus tard, une prise de conscience des associations apparaîtra pour intervenir à l'avenir d'une façon organisée sur l'ensemble du territoire et non plus seulement en montagne…
Année 1962 - Le COSIROC
Création du COSIROC, un Comité de coordination qui aura comme but la défense des sites et des rochers d'escalade de Fontainebleau, avec initialement deux grandes actions :
< le rattachement du massif des Trois Pignons à la forêt domaniale de Fontainebleau.
< la création de la base de plein air de Buthiers-Malesherbes, évitant un projet d'urbanisation…
Le Cosiroc deviendra une association indépendante en 1967.
Parallèlement en venant appuyer l'administration, le Club Alpin et la FFM se prononcent pour l'interdiction de toute circulation automobile dans la forêt domaniale de Fontainebleau, en dehors des voies goudronnées ; des voitures qui s'introduisaient partout dans les sous-bois...
Année 1963 - Les chaussons EB
En 1962, apparaissait un modèle de chausson d'escalade concurrent des PA : La Varappe RD de Galibier.
Pierre Allain diffusera ses propres chaussons PA jusqu'en 1962. Il s'installera ensuite à Uriage en 1963, pour poursuivre le développement et la fabrication de ses mousquetons en alliage d'aluminium.
C'est en 1963 que le modèle d'origine échappera à son inventeur et sera récupéré par son fabricant-cordonnier Bourdonneau qui proposera le chausson bleu d'origine, mais sous sa propre marque et sigle EB super-gratton.
En 1964, un modèle nouveau : Varappe PA Galibier, appelé « nouvelle PA » est proposé.
C'est en 1966, que le chausson d'origine figurera dans les publicités sous la marque : Super gratton EB, il restera pour encore quelque temps le modèle de référence.
Puis d'autres fabrications viendront…
En 1967, les chaussons font leurs apparitions dans les falaises et aussitôt dans les escalades rocheuses des Alpes… et, à partir de 1974, les chaussons PA devenus EB et leurs dérivés seront indispensables pour toute escalade rocheuse difficile ou pas, en tous lieux permettant bientôt des progrès notables dans l'escalade rocheuse…
Année 1964 - Le domaine des Trois Pignons
Quelques initiatives privées et les instances du Club Alpin vont réclamer que le domaine des Trois Pignons, élément essentiel de la forêt de Fontainebleau, soit mis hors de portée des promoteurs.
La forte mobilisation des familiers de la forêt de Fontainebleau était réelle et perceptible, ces usagers s'estimaient victimes du mauvais coup de l'administration, qui n'avait pas hésité à couper la forêt en deux, pour faire passer l'autoroute en son milieu.
Voulant peut-être atténuer ce fiasco environnemental, l'administration se portera acquéreur des zones encore non protégées de l'exceptionnelle forêt…
L'enquête publique en vue de l'expropriation de l'ensemble du massif des Trois Pignons débutera en 1966, l'arrêté de la déclaration d'Utilité publique date du 20 octobre 1967, avec le rachat par l'État de près de deux mille propriétés constituant le massif...
Le domaine de Bois Rond, déjà acheté par l'Armée en 1952 - ce qui évita l'appropriation privée de cet autre espace unique -, et le secteur de Coquibus, déjà acquis par l'État, entrent dans les limites de l'arrêté...
- Le circuit saumon
Parcours majeur dans le massif des gorges d'Apremont, conçu pour la préparation physique à la haute montagne, le circuit saumon est tracé par Jacques Reppelin et Pierre Porta, long parcours de difficulté moyenne en cinquième degré, qui peut se réaliser en une heure, il a déjà été parcouru en quarante-cinq minutes, mais on peut aussi prendre son temps dans le cadre magnifique des gorges d'Apremont. La difficulté d'ensemble du circuit est qualifiée de très difficile limite inférieure (TD inf.).
Année 1967 - La gestion des circuits
Le COSIROC, avec sa commission des circuits d'escalade, devient de fait le gestionnaire du patrimoine escalade de blocs en forêt de Fontainebleau, en liaison, bien sûr, avec l'administration de l'Office National des Forêts.
C'est Lucien Deschamps et Pierre Bontemps qui sont les premiers à prendre en charge la gestion des circuits d'escalade. C'est Oleg Sokolsky qui assurera, à partir de 1975, l'immense travail de coordination, d'entretien et de gestion de quelque deux cents circuits d'escalade de la forêt de Fontainebleau.
Année 1968 - D'autres circuits blancs
Patrick Cordier trace deux circuits de haute difficulté dans les groupes de Franchard et du 95,2. La difficulté moyenne est le cinquième degré limite supérieure, l'enchaînement d'un pareil circuit est une performance physique.
La difficulté d'ensemble des deux circuits est qualifiée de très difficile, limite supérieure (TD sup.).
- Les chemins forestiers
Les chemins forestiers de la forêt de Fontainebleau sont peu à peu fermés aux automobiles qui s'engageaient partout et saccageaient les sols.
DANS LES ANNÉES 1970
Année 1972 - Le circuit noir
Alain Michaud à Malesherbes et Jacques Olivet au Gros Sablon commencent à exporter la haute difficulté hors du Bas Cuvier, en traçant des circuits extrêmement difficiles.
Dans le massif du Gros Sablon, le circuit noir de Jacques Olivet restera une référence combinant l'extrême exposition et la haute difficulté. La difficulté moyenne est 6A exposé, la difficulté d'ensemble du circuit est qualifiée d'extrêmement difficile limite inférieure (ED inf.).
- Le circuit des 25 bosses
Le parcours de randonnée des 25 bosses, dans le massif des Trois Pignons, est achevé par Maurice Martin et ses amis. Il reprend une succession de sentiers existants, avec des variantes de raccordement. Il offre une dénivellation finale assez sérieuse (850m), comme préparation à la montagne…
Année 1977 - Le renouveau
Un renouveau dans l'escalade de blocs vient avec Jérôme Jean-Charles et ses amis qui, depuis quelques années, sont les continuateurs de la tradition au Bas Cuvier.
L'entraînement journalier permet des avancées, c'est « Carnage » avec 7B pour la difficulté (en 1983), sur le même bloc que l'Abattoir.
Année 1978 - Le Toit du Cul de Chien
Sur un bloc isolé, un peu comme celui de la Fissure des Alpinistes, il faut aller à sa rencontre, le « Toit du Cul de Chien » est un passage des plus spectaculaires, il est réussi par Eddy Bouchet. Difficulté 6C seulement, mais avec beaucoup d'allure...
- La magnésie
Début de l'utilisation de la magnésie comme aide à l'escalade. La poudre blanche va déclencher de belles polémiques : la magnésie est-elle un moyen artificiel d'escalade ?
Pourtant la magnésie était déjà utilisée par quelques gymnastes grimpeurs de la forêt dans les années mil neuf cent cinquante… Notamment par un familier de Buthier-Malherbes, à la place de la résine pilée.
La résine pilée était utilisée pour le bloc à Fontainebleau dans l'avant guerre 1939-1945.
- L'échelle des difficultés
Il n'y a pas de lien entre l'échelle des difficultés en falaise et en bloc, ce sont deux systèmes parallèles qu'il faudra peu à peu s'approprier… Longtemps l'échelle se rapportant au bloc comportait des chiffres romains pour se bien différencier de la cotation falaise...
Aujourd'hui il semble que la tendance soit aux chiffres arabes avec une lettre majuscule...
Les grimpeurs décident d'ouvrir le système de graduation des difficultés, limité jusque-là aux six degrés du système Welzenbach, après 6 ce sera 7 puis 8....
A chaque degré, il y a trois paliers intermédiaires A, B et C. Les avancées supplémentaires sont marquées par un plus (7A+ par exemple).
Tout ceci pour éviter l'inflation...
- Les longues traversées
Jean-Pierre Bouvier inaugure une série de traversées remarquables sans repos, exigeant une grande continuité. Une référence parmi d'autres : la Mygale (7B) à Buthiers-Malesherbes cette année là. Il en deviendra un spécialiste et atteindra les plus hautes difficultés du moment des années suivantes.
Année 1979 - Le massif des Trois Pignons préservé
Après beaucoup d'incertitudes et de discussions, l'État a achevé l'acquisition du massif des Trois Pignons qui est confié à l'Office National des Forêts (ONF).
DANS LES ANNÉES 1980
Année 1980 - La guerre des flèches
La guerre éclate entre les tenants d'une organisation rationnelle de l'escalade et de son développement en multipliant les circuits fléchés et un petit groupe voulant imposer le retour à la nature vierge. Les fléchages peints sur les blocs sont effacés au chalumeau, puis retracés pour être de nouveau détruits...
Le retour au calme interviendra deux années plus tard...
Année 1981 - Les nouveaux chaussons
En 1981, apparition sur le marché de chaussons d'escalade de fabrication espagnole avec un caoutchouc très tendre et comportant en additif de la résine. Cet équipement va aider à faire avancer dans la difficulté.
Année 1982 - Le guide de Bleau
Parution d'un guide complet de l'escalade en forêt de Fontainebleau, aux Éditions Arthaud.
La difficulté d'ensemble de chaque circuit est indiquée suivant l'échelle en six degrés : facile (F), peu difficile (PD), difficile (D), très difficile(TD) et extrêmement difficile (ED), avec des paliers intermédiaires, inférieur et supérieur.
Année 1983 - Un nouveau progrès en 7C
Au Bas Cuvier, c'est la « Berezina » par Pierre Richard, avec une difficulté estimée 7C, sur le même bloc que l'Abattoir, qui devient pour le septième degré, un autre haut lieu du Cuvier et de la forêt de Fontainebleau, avec le bloc aux deux arêtes pour le six, et le bloc de la Prestat pour le cinquième degré.
- Performance britannique
Le grimpeur britannique Jerry Moffat, en visite, réussit au Bas Cuvier l'Abattoir après un seul essai et Carnage au second essai…
Ce qui montre le haut niveau dans l'escalade de blocs du meilleur grimpeur des Îles Britanniques du moment.
- Le surplomb de la vallée de la Mée
Encore une progression dans la difficulté, le « Surplomb de la vallée de la Mée » est réussi par Jacky Godoffe et Alain Ghersen. Les grimpeurs lui attribuent le degré 7C limite supérieure. On veut marquer une avancée, mais on n'ose pas encore entrer dans le huitième degré, pas pour longtemps...
- Les chaussons modernes
Avec le blocage du talon, les semelles adhérentes et la grande précision du chausson, le grimpeur gagne un degré entier dans l'échelle des difficultés du bloc.
Année 1985 - Le premier huit
Le consensus entre les grimpeurs est obtenu, la progression dans la difficulté est bien réelle. Nous sommes devant le premier huit, dans l'échelle de la difficulté bleausarde, avec « C'était demain » par Jacky Godoffe, au Rempart du Cuvier.
Année 1986 - Les quatre huit
Alain Ghersen inaugure « L'Ange naïf », dans le groupe des rochers du 95,2 ; et « Partenaire particulier », dans le groupe de l'Éléphant, avec Jacky Godoffe...
Ce dernier réussit « La Balance » au Cuvier. Ces passages vont mériter, avec « C'était demain », le huitième degré de difficulté en bloc...
Année 1987 - L'ensemble des voies difficiles
Alain Ghersen réussit à gravir l'ensemble des voies extrêmes de la forêt de Fontainebleau, c'est-à-dire 7A et plus.
Année 1988 - École de blocs, école de Bleau
La revue La Montagne & Alpinisme n°2/1988 propose un essai de chronologie sur l'escalade de blocs.
Année 1989 - Le premier 8B bloc ?
Jacky Godoffe inaugure le « Mouvement perpétuel » au Cuvier, estimé 8B, en concurrence avec ce qui suit...
DANS LES ANNÉES 1990
Dans les années 1990 se développe, partout en Europe et dans le monde, l'escalade de blocs.
- Le « crash pad »
Un matelas amortisseur « crash pad » bricolé est utilisé pour sécuriser les chutes, un modèle plus technique sera commercialisé dès 1995. Les « anciens » se demandent encore comment ne pas y avoir pensé plus tôt.
- La parade des collègues qui assurent la sécurité…
Jadis le sable au pied des blocs assurait une certaine sécurité dans les chutes au sol, avec les nombreuses voies nouvelles proposées, le sable n'est pas toujours présent, et c'est la parade des collègues qui doit assurer la sécurité, avec le crash pad, c'est une technique qui ne s'improvise pas, et réclame souvent la présence d'au moins deux pareurs qui doivent savoir être vigilants et savoir anticiper…
Année 1992 - Le premier 8B ?
À Branson en Suisse, Fred Nicole réalise « La danse des Balrogs » qui se revendique également comme le premier 8B de l'escalade de bloc.
Année 1993 - Fat Man au Cuvier
Au Bas Cuvier, Jacky Godoffe réalise les mouvements de « Fat Man », un surplomb en 8B.
LE XXIe SIÈCLE
Un curseur nécessaire
Notons que, depuis quelques temps, avec les niveaux vertigineux atteints, et en l'absence d'un curseur indiscutable, les progrès annoncés demandent la confirmation des collègues... de ce niveau.
Et en la présence de l'un d'eux, pour éviter les fantasmes et autres chimères.
Année 2001 - Des actes de pur vandalisme
Des itinéraires notoires sont saccagés, avec des dommages définitifs, comme Carnage et Fat Man, du fait d'irresponsables âneries ou autres errements…
La bêtise humaine n'a pas de limite.
Année 2014 - Les fantastiques évolutions de l'escalade
En 2014, un certain nombre de 8C et un grand nombre de 8B parsèment la belle forêt, ils marquent les fantastiques évolutions de l'escalade à Fontainebleau… avec les éternelles discussions sur le niveau proposé par l'ouvreur, et celui ressenti par le répétiteur...
Le niveau 8C
Risquons quelques jalons marquant le niveau 8C ayant trouvé un certain consensus :
< « Dernier Fléau », au Rempart du Cuvier, par Sébastien Frigault en 2003.
< « Trip Hop », à Boissy aux Cailles, par Sébastien Frigault en 2003.
< « The Big Island », à Coquibus Rumont, par Vincent Pochon en 2009…
Les derniers mouvements extrêmes du moment
En 2016, plusieurs blocs extrêmes sont inaugurés, comme « La Révolutionnaire » 8C, par Charles Albert dans le secteur Gros Sablon.
En 2017, la ligne « Belial » 8C au Bas Cuvier, réalisée au printemps par Charles Albert.
En 2018, version assise du mouvement « Hypothèse » au Bas Cuvier en 8C+, par Charles Albert, et aussi « Délire onirique assis ».
En 2018 la ligne de « No Kpote Only » du secteur Rocher brulé est proposée 9A par Charles Albert.
Avec les polémiques que l'on imagine pour le premier mouvement de ce niveau à Fontainebleau.
Année 2020 - Le 8C féminin
Oriane Bertone inaugure « Satan I Helvete Bas » dans le secteur Coquibus, elle est la quatrième grimpeuse dans le monde du bloc à atteindre ce niveau 8C, un bloc ensuite repris par deux garçons.
Du « mathieu » aux « pures lumières »
- Avec ses quelque deux cents circuits d'escalade, allant depuis le commode parcours pour tous jusqu'aux blocs et circuits réservés aux « pures lumières », la forêt de Fontainebleau est, pour l'escalade de blocs, un terrain de jeu sans égal.
Pour tout savoir
Pour tout savoir sur les voies d'escalade : https://bleau.info
LES SUITES DE LA CHRONOLOGIE DE CE DOSSIER DEVRONT ÊTRE AJOUTÉES ULTÉRIEUREMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 - L'ESCALADE GLACIAIRE EN SITE NATUREL ET ARTIFICIEL
Année 1975 - L'escalade des cascades de glace et des goulottes
Les progrès du matériel et des techniques, venus d'Écosse au début des années 1970, vont transformer complètement les façons de faire des alpinistes.
Dès 1975, se développe en France, d'abord sur les parois du cirque de Gavarnie, l'escalade des rideaux de glace à l'existence éphémère - les cascades de glace - et bientôt en haute montagne seront trouvés des cheminements nouveaux, par des goulottes glaciaires.
Ce sera une heureuse ouverture pour les novateurs qui pourront revisiter les grandes parois nord d'Europe, puis du monde.
Une escalade de haut niveau va peu à peu se développer sur les rideaux naturels de glace qui se forment chaque hiver.
Lire un historique étendu dans la revue LM&A n°4-2023 : L'escalade sur glace.
Année 1998 - L'escalade sur glace de compétition
Après divers tâtonnements et depuis 1998, on assiste à un intérêt notable pour une forme de compétition d'escalade glaciaire sur structure artificielle et rideau de glace.
Un équipement de premier ordre, que possède la commune de Champagny-en-Vanoise, permet cette pratique sportive hivernale, qui peut s'envisager aussi comme un loisir sportif de mi-décembre à mi-mars.
Petit à petit, les premières règles communes, pour régir l'escalade sur glace de compétition, apparaissent.
Année 2000 - L'escalade sur glace de compétition
La première coupe du Monde Internationale a lieu en 2000. À l'instar de l'escalade rocheuse, les épreuves se déroulent sur des structures artificielles et sur les rideaux éphémères de glace, avec des concours de vitesse et de difficulté.
Année 2002 - L'UIAA est l'organisateur
En 2002, l'UIAA organise un circuit international, l'Ice Climbing Tour
Année 2012 - Des compétitions d'escalade sur glace en France
Dans le prolongement de ses actions d'animation touchant l'escalade sur glace, la FFCAM coorganise avec la commune de Champagny-en-Vanoise, l'étape française de la coupe du monde, sur structure artificielle (Ice World Climbing) du 2 au 4 février 2012, répondant ainsi à la demande de l'UIAA, en charge de l'organisation internationale.
C'est une première épreuve française, regroupant 21 pays et 90 compétiteurs, pour cette activité hivernale qui s'est déroulée avec succès, sur l'équipement de premier ordre que possède la commune de Champagny-en-Vanoise. Une structure artificielle constituée d'une tour aménagée couverte de glace, d'une hauteur de 24 m, et proposant des dévers de 15 m.
Année 2017 - Cascade de glace et compétition
La revue LM&A n°3/2017, présente un article : Cascade de glace et compétition, par Adrien Pirolo.
Année 2022 - La FFCAM devient délégataire
Par l'arrêté du 16 décembre 2022, la Fédération française des clubs alpins et de montagne devient délégataire de la discipline escalade de glace en compétition.
À l'origine redisons-le, c'est une activité dérivée de l'alpinisme et de l'escalade, qui consiste à grimper le long de formations glaciaires à l'aide de piolets et crampons en s'assurant par la mise en place de broches à glace, ou autres ancrages artificiels. Cette pratique apparaît en 1975 et se développe d'abord en dehors d'un cadre de compétition.
Petit à petit, les premières règles communes pour régir l'escalade sur glace compétitive apparaissent en 1998. La première Coupe du Monde Internationale a lieu en 2000. À l'instar de l'escalade séche, les compétitions se déroulent sur structures artificielles, avec des épreuves de vitesse et de difficulté.
Aujourd'hui, un circuit mondial, l'Ice World Cup, est bien établi et la discipline cherche également à devenir sport olympique.
L'étape française de Coupe du monde a lieu un an sur deux sur la tour de glace de Champagny-en-Vanoise, (en 2023, les 20 et 21 janvier). Les meilleurs grimpeurs internationaux issus de 23 nations différentes se confrontent sur deux épreuves : l'une de « vitesse » qui représente un sprint vertical sur la glace et la seconde sur un principe de « difficulté » sur une voie mixte en dry tooling et englacée, annoncée comme la plus difficile du monde.
LES SUITES DE LA CHRONOLOGIE DE CE DOSSIER DEVRONT ÊTRE AJOUTÉES ULTÉRIEUREMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSULTATION
La plupart des textes concernant l'historique de la montagne et de la FFCAM sont disponibles au Centre fédéral de documentation de la FFCAM, 24, avenue de Laumière, 75019 Paris.
Notamment dans les différentes publications :
- Les Annuaires du CAF, de 1874 à 1903.
- Les Bulletins du CAF, de 1876 à 1903.
- La Montagne, de 1904-1905 à 1954.
- Alpinisme, de 1925 à 1954.
- La Montagne & Alpinisme, depuis 1955.
- Les Annales du GHM, de 1955 à 2001 et Cimes, de 2002 à 2015.
Les livres constituant la bibliothèque de la FFCAM sont tous référencés.
CONSULTATION EN LIGNE
Accès aux références
Vous pouvez consulter en ligne le catalogue du CFD avec un accès aux références pour l'ensemble des articles des périodiques et pour les livres.
Il suffit de saisir un mot caractéristique ou un des mots clés d'un ouvrage recherché, dans l'un des champs appropriés (auteur, titre, sujet, année d'édition) et vous aurez accès aux références.
Accès aux publications
Vous pouvez rechercher en ligne les titres suivants :
- Les Annuaires du CAF, de 1874 à 1903, consultables sur le site de la Bibliothèque nationale : http://gallica.bnf.fr
- Voir aussi : www.archive.org et utiliser le mot clé : club alpin français.
- Les Bulletins du CAF, de 1876 à 1903, consultables sur le site de la Bibliothèque nationale : http://gallica.bnf.fr
- La Montagne, de 1904-1905 à 1954, consultables sur le site de la Bibliothèque Nationale : http://gallica.bnf.fr
- La Montagne & Alpinisme, depuis 1955, consultables sur le site de la Bibliothèque nationale : http://gallica.bnf.fr
- Enfin, Alpinisme, de 1926 à 1954, accessibles sur le site du GHM, avec Les Annales du GHM (1955-2001) et Cimes (2002-2015).



